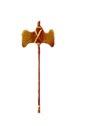
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007
Planète queer et politique de la multitude
Colette St-Hilaire
Résumé
Dans « Planète queer et politique de la multitude »[1], Colette St-Hilaire s’interroge sur la signification politique de la mouvance queer. Elle l’aborde du point de vue d’une politique de l’événement : après Stonewall en 1969 à New York, après la descente du Truxx en 1977 à Montréal, un chantier s’est ouvert, bouillonnant d’activités. On a vu naître des théories et des militantismes de toutes sortes, des organisations économiques, culturelles et sociales, bref les puissances de vie queer se sont déployées dans toutes les directions. Est-ce à dire que la libération sexuelle est à nos portes ? Serait-ce plutôt que le capitalisme postfordiste a développé de nouveaux modes de contrôle, souples, invisibles, adaptés aux individus à l’identité précaire et éclatée ? En utilisant le concept de multitude, Colette St-Hilaire tente de démontrer que les mouvements queer échappent à ces catégorisations. « La multitude queer est monstre, projet, débordement, variation, fuite. »
La nouvelle visibilité des gais et des lesbiennes, et des minorités sexuelles historiquement plus marginalisées encore, et la liste de leurs droits nouvellement acquis dans les pays industrialisés, donnent lieu à des appréciations qui me laissent parfois songeuse : par exemple, quand on les célèbre comme les victoires d’un mouvement identitaire qui a su briser les chaînes de l’oppression, dans la tradition des mouvements de libération ouvriers ou féministes ; quand on y décèle des modes de vie moralement supérieurs ; ou lorsqu’au contraire on n’y voit que marchandisation et récupération, jusqu‘à en faire des avatars de la mondialisation néo-libérale.
Aucun de ces constats n’est convaincant. Si je ne suis pas très chaude à l’idée de chanter la gloire du mariage gai ou la vertu des mères lesbiennes, je me vois mal les dénoncer comme de simples reconfigurations du pouvoir ou de la domination. J’ai plutôt la conviction que quelque chose de fondamental est en train de se produire, que l’émergence de la « planète queer » est un moment historique important, porteur de problèmes certes, mais riche aussi de nouvelles possibilités.
Les outils théoriques dont nous disposons pour analyser ces mutations sont récents. On les a élaborés au sein du féminisme, des études gaies et lesbiennes, des cultural studies et des queer studies. Le corpus est imposant. En y combinant les analyses des transformations du capitalisme des Hardt & Negri, Lazzarato, Virno et autres, l’on peut commencer à prendre la mesure de ce qui se passe.
Être attentif à l’événement
On ne peut penser la mouvance queer nord-américaine sans évoquer l’événement que fut l’émeute de Stonewall. Nous sommes en 1969, à New York. La police décide de nettoyer la place et fait une descente dans un bar de travestis, le Stonewall Inn. Ce n’était pas la première descente, mais ce jour-là, les choses ne se passèrent pas comme à l’accoutumée : avec leurs talons hauts et leurs paillettes, les drag queens sortirent dans la rue et, avec l’aide des copines des bars avoisinants, livrèrent bataille dans tout le quartier pendant plusieurs jours. Après Stonewall, rien ne fut plus jamais pareil. Les subjectivités avaient changé : « On ne supporte plus ce qu’on supportait auparavant, “la répartition des désirs a changé” dans l’âme (Lazzarato,2004 :10). »Le mouvement gai était entré en scène.
Montréal a connu son événement aussi : en 1977, la police fait une descente au bar Truxx et arrête soixante hommes qu’elle accuse d’indécence. La réaction est immédiate : des milliers de personnes descendent dans la rue, les journaux répercutent l’événement, le mouvement gai montréalais vient de réussir sa sortie.
Dire qu’il y a eu événement, c’est dire que quelque chose dans tout cela était imprévisible. Une naissance non annoncée. Aucun parti ne présidait aux destinées des mouvements gais américains, aucun programme n’en avait programmé les étapes, personne n’avait prévu qu’ils émergeraient du développement des forces productives non plus. Pourtant, l’événement est survenu et a changé la donne ; de nouvelles possibilités se sont alors ouvertes, dont nous avons du mal aujourd’hui encore à mesurer toute l’ampleur : « L’événement donne à voir ce qu’une époque a d’intolérable mais fait aussi émerger de nouvelles possibilités de vie. Cette nouvelle distribution des possibles et des désirs ouvre à son tour un processus d’expérimentation et de création. (Lazzarato,2004 :10) »
La politique, si on la pense dans l’optique de l’événement, est risquée ; elle consiste moins à planifier qu’à prêter l’oreille : « Non pas prédire, mais être attentif à l’inconnu qui frappe à la porte » dit Deleuze. L’événement ouvre un chantier où tout est mobile et désorganisé. Reste à s’y retrouver, à créer, à agencer de nouvelles formes de vie, à bricoler avec les outils dont nous disposons.
Depuis les années 70, ce chantier, gai d’abord, queer ensuite, n’a cessé de bouillonner d’activité, les puissances de la vie s’y sont déployées : on a bougé côté militant ; on s’est activé côté théorie ; on s’est articulé aux forces qui se mettaient en place dans le capitalisme post-industriel et on a construit de nouveaux dispositifs : droits des conjoints de même sexe, union civile, mariage gai, homoparentalité. Et on les a aussitôt débordés.
We’re here, we’re queer, get used to it !
À l’origine, le terme queer était utilisé pour désigner, de manière péjorative, les homosexuels : « He’s queer ! C’est un pédé! » Jusqu’à ce que des militants gais et lesbiennes américains se réapproprient l’expression avec défi et en exposent l’hétéronormativité : « We’re here, we’re queer, get used to it ! » Leur geste n’était pas sans rappeler celui des militants du Black Power qui, dans les années 60, scandaient « Black is beautiful ». Avec les années, le qualificatif queer a fini par recouvrir un ensemble de discours et de pratiques associés à la transgression des frontières de la différence des sexes et de l’hétéronormativité. Aujourd’hui, les lesbiennes, les gais, les personnes bisexuelles, travesties, transsexuelles ou intersexuées, les sados-masos, les pédérastes[2] et autres « hors-la-loi du sexe » sont les principaux habitants de la planète queer.
Au niveau politique, les courants queer ont connu leur impulsion à la fin des années 80 aux États-Unis au plus fort des mobilisations contre le sida et en pleine montée de la droite, alors qu’était fortement ressentie la nécessité d’une alliance de toutes les forces, laquelle ne pouvait être basée que sur des affinités et des intérêts provisoires, sans égard à l’identité, à l’orientation ou aux pratiques sexuelles. Queer Nation, Act Up, Lesbian Avengers, OutRage! sont parmi les groupes ayant le plus incarné ce militantisme queer, non conventionnel, post-identitaire, décentralisé, local, s’exprimant au moyen de sit-in, d’affichage, de parodies et de manifestations culturelles de toutes sortes. Le sida n’explique toutefois pas tout.
Si le mouvement queer s’est construit dans la lutte contre l’État et la droite américaine, il fut aussi une réaction à l’institutionnalisation des mouvements gais et lesbiens, aux illusions réformistes qu’ils portaient et à leurs effets d’exclusion relativement à la race ou à certaines pratiques sexuelles marginales.
Montréal a suivi le mouvement. Les années soixante ont vu naître tout un réseau de lieux de sociabilité pour les gais : bars, restaurants, saunas se sont multipliés en même temps que naissaient les publications et les groupes politiques. On se souviendra de la revue contre-culturelle Mainmise qui avait publié le Manifeste du Front de libération des homosexuels. Dès la fin des années soixante-dix, la Charte des droits et libertés interdit la discrimination et accorde une première reconnaissance aux gais et aux lesbiennes.
C’est la grande sortie officielle, le mouvement s’institutionnalise. De ghetto pour minorités, le village gai se transforme en site commercial et touristique ; la Chambre de commerce gaie ne tardera pas à voir le jour. Dans les universités, les choses vont plus lentement, mais les savoirs s’institutionnalisent peu à peu, notamment avec l’organisation du colloque La ville en rose à l’UQÀM et à Concordia.
Même si les mobilisations contre le sida n’ont jamais eu autant d’ampleur et de radicalité à Montréal qu’aux États-Unis, le Québec peut maintenant compter sur l’action haute en couleur de ses Panthères roses et de ses Ass Pirates, jeunes queers et empêcheurs de tourner en rond qui prennent un plaisir malin à se situer à la frontière d’une communauté gaie fortement institutionnalisée et d’un mouvement anarchiste fortement hétérocentré, comme l’explique Jujube dans l’entretien qu’il nous a accordé pour ce numéro.
La mouvance queer — entendue au sens large et incluant tout ce qui va à l’encontre de l’hétéronormativité, des groupes de gais ou de lesbiennes traditionnels jusqu’aux jeunes queer radicaux — s’est rapidement étendue et ses réseaux se sont mondialisés, jusqu’à se tailler une place dans les forums parallèles et se faire entendre dans les coulisses des Nations-Unies[3].
Penser queer
Les courants queer actuels proposent un modèle analytique qui met en lumière les incohérences dans les relations supposées stables entre sexe, genre et désir. Cette analyse a été amorcée il y a plusieurs années déjà par des théoriciennes féministes comme Gayle Rubin, Adrienne Rich, Monique Wittig et Nicole-Claude Mathieu, qui ont placé la question de la contrainte à l’hétérosexualité au coeur de leur analyse du système de sexe/genre. Dans ces théories, la binarité du sexe apparaît comme une catégorie construite, comme le résultat d’un système d’appropriation, d’un système social de genre, hétéronormatif, au service de la reproduction. Aux côtés de l’homme et de la femme émerge la figure de la lesbienne, une lesbienne devenue sujet, elle qui devait n’être que l’Autre, une Autre constituée et invisibilisée dans le mouvement de création du sujet et de son illusoire autonomie.
Mais malgré l’étonnante actualité de ces thèses au regard de la théorisation du sexe, elles apparaissent aujourd’hui prisonnières d’une vision très moderniste du sujet et de la libération sexuelle. Wittig conçoit l’hétérosexualité comme la pierre angulaire d’un système social totalisant. L’adhésion aux catégories, la foi en leur naturalité, permet d’édifier un système d’exploitation patriarcale et sociale. Avec sa déclaration choc « Les lesbiennes ne sont pas des femmes. », Wittig insiste sur la possibilité stratégique d’échapper à ce système. Elle fait ainsi des lesbiennes le sujet historique par excellence dont la mission est de transformer de fond en comble ce système.
Rich quant à elle considère l’hétérosexualité comme une contrainte imposée par le patriarcat pour maintenir les femmes dans un état de dépendance. Les femmes résistent à divers degrés à cette dépendance, ce qui permet à Rich de tracer un continuum à l’extrémité duquel elle place les lesbiennes, faisant d’elles le sujet historique de la libération de toutes les femmes. Rubin, pour sa part, insiste sur le caractère social de toute activité humaine, y inclus la sexualité, qu’elle conçoit comme emprisonnée dans le système de genre, mais elle n’envisage pas moins un au-delà du système de sexe/genre, un monde peuplé de créatures androgynes, sans genre mais non sans sexe, des sujets autonomes libérés de la contrainte du système de genre.
Ce féminisme matérialiste radical n’est pas la seule source des courants queer actuels, loin s’en faut. L’apport des féministes des pays du Sud et des minorités ethniques, souvent oublié, est considérable. Je pense ici à Charlotte Bunch (Passionate Politics, 1987), Audre Lorde (Sister Outsider 1984), Gloria Anzaldua et Cherrie Moraga (This Bridge Called my Back : Writings of Radical Women of Color 1981) et bell hooks (Ain’t I a Woman 1981 et Talking Back 1989) parmi d’autres, qui, par leurs écrits et leur militantisme, ont travaillé sans relâche à débusquer le racisme et l’hétérocentrisme inhérents aux discours et aux pratiques féministes et, ce faisant, ont contribué à faire éclater l’illusoire unité du sujet du féminisme et à faire reconnaître la multiplicité et la différence.
Elles expriment ce que Hardt et Negri appellent un désir de multitude : le désir d’un monde où les différences prolifèrent et ne sont le prétexte d’aucune discrimination.
Un autre pas allait être franchi avec le courant féministe post-structuraliste, incarné par des auteures comme Rosi Braidotti, Donna Haraway, Teresa de Lauretis, qui ont toutes proposé de nouvelles définitions du sujet-femme incluant les idées de multiplicité, d’hybridité, de précarité — le sujet nomade chez Braidotti, le cyborg chez Haraway, le sujet excentrique chez de Lauretis. Dans cette foulée, le travail de Judith Butler apparaît tout à fait novateur. Dans Gender Trouble (1990), Butler analyse la configuration du pouvoir qui est à l’origine de la construction de la relation binaire entre les sexes et de la stabilité de cette relation. Qu’adviendrait-il de cette stabilité, se demande-t-elle, si le régime de l’hétéronormativité était pointé du doigt comme responsable de la production de ces catégories ? Délogeant le sexe de tout fondement métaphysique, Butler suggère que le genre produit lui-même la catégorie naturelle sexe qui paraît le fonder :
Si le sexe devenait une catégorie dépendante du genre, la définition même du genre comme interprétation culturelle du sexe perdrait tout son sens. On ne pourrait plus alors concevoir le genre comme un processus culturels qui ne fait que donner un sens à un sexe donné (c’est la conception juridique) ; désormais, il faut aussi que le genre désigne précisément l’appareil de production et d’institution des sexes eux-mêmes. En conséquence, le genre n’est pas à la culture ce que le sexe est à la nature ; le genre, c’est aussi l,ensemble des moyens discursifs/culturels par quoi la « nature sexuée » ou un « sexe naturel » est produit et établi dans un domaine « pré-discursif », qui précède la culture, telle une surface politiquement neutre sur laquelle intervient la culture après coup (Butler,2005 :69).
En d’autres termes, au lieu de considérer le sexe comme le donné biologique non théorisable sur lequel viendrait s’inscrire un élément culturel, le genre, divisant et hiérarchisant les humains en deux catégories distinctes, à la fois naturelles et culturelles, Butler suggère que la catégorie ontologique sexe est elle-même produite et naturalisée dans le genre, véritable appareil de production du sexe, matrice de pouvoir phallocentriste et hétéronormative. Dans cette approche, la stabilité même des catégories homme-femme, hétérosexuel-homosexuel, devient problématique, tout comme les mouvements qui prétendent en faire le fondement de leur lutte. L’influence poststructuraliste, ou plus précisément une lecture américaine de Foucault et de Lacan, est décelable dans cette conceptualisation de l’identité comme une fiction, provisoire et contingente, dépendante des régimes de pouvoir. En effet, chez Butler, il n’existe pas de sujet qui soit antérieur à son sexe ou à son genre; le sujet lui-même est constitué dans l’actualisation des normes des régimes de sexualité en vertu de ce que Butler appelle la performativité du genre :
Le genre est performatif dans la mesure où il est l’effet d’un régime régulateur de différences des sexes au sein duquel les genres sont divisés et hiérarchisés sous la contrainte. Les contraintes sociales, les tabous, les interdits et les menaces de punition opèrent dans la répétition ritualisée des normes, et cette répétition constitue la scène temporelle de la construction et de la déstabilisation des genres. Il n’y a pas de sujet qui précède ou exécute cette répétition des normes. Dans la mesure où cette répétition crée un effet d’uniformité de genre, un effet stable de masculinité ou féminité, elle produit et déstabilise la notion de sujet elle-même, parce que le sujet n’est intelligible que dans une matrice de genre. [...]
Il n’y pas de sujet qui soit « libre » d’échapper à ces normes ou de les négocier à distance; au contraire, le sujet est rétroactivement produit par ces normes dans leur répétition, précisément comme leur effet (Butler, ?: 16-17).
Le sujet — le sujet en général et le sujet sexué — apparaît donc chez Butler comme le produit de régimes de contrainte. Son existence n’est pas antérieure à ces régimes. Butler s’écarte ici du féminisme matérialiste français (Delphy, Mathieu et Wittig, par exemple) qui n’ont pas renoncé à l’idée d’un sujet humain antérieur aux rapports sociaux qui l’emprisonnent. Son identité, bien qu’elle ne soit pas réductible à la contrainte, ne saurait être le fondement d’une libération. Se libérer exigera plutôt de déloger de leur fondement métaphysique ces catégories qui organisent la production des sujets sexués et les inscrivent dans les limites du phallocentrisme et de la contrainte à l’hétérosexualité.
Parce qu’elle posait des fondements théoriques d’une radicalité exceptionnelle, l’œuvre de Butler a eu in retentissement énorme. Mais d’autres textes ont fortement marqué la planète queer : je pense à Eve Sedgwick et à son Epistemology of the Closet; à Michael Warner et à son The Trouble With Normal, dans lequel il dénonce le nettoyage homophobe opéré par le maire Giuliani à New York (fermetures de bars, de saunas et de librairies, nettoyage des parcs, etc.), analyse le virage à droite du mouvement gai américain — il fustige les partisans du mariage gai et de l’entrée dans l’armée —, et milite en faveur de la libre expression de la subjectivité des marginaux du sexe; sa défense des activités sexuelles nocturnes dans les parcs est d’ailleurs remarquable.
Avec le temps, les travaux et les auteur-e-s se sont multipliés, et le vocable queer a fini par recouvrir une grande variété de positions théoriques dont les contours sont difficiles à établir : ils réfèrent à l’idée d’une fluidité, d’une suspension de l’identité; à la remise en question de la viabilité et de l’utilité politique des catégories de l’identité sexuelle; à la transgression des normes sexuelles, à la multiplication des identités et des pratiques marginales. Être queer, c’est brouiller les frontières, mélanger les genres, promouvoir l’instabilité et l’indécidabilité des identités.
Ce brassage d’idées queer a mis du temps à traverser l’Atlantique. Il a fallu attendre 2005 pour que les livres de Butler soient traduits en français. Les autres attendent toujours. Cela n’a pas empêché totalement la mouvance queer de prendre racine en France. Depuis quelques années, deux noms incarnent cette mouvance ; Marie-Hélène Bourcier, auteure de Queer zones. Politique des identités sexuelles, des sexualités et des savoirs et animatrice du Zoo, un séminaire queer qui squatte à la Sorbonne ; et Beatriz Preciado, auteur du Manifeste contra-sexuel. Deux impertinentes de premier ordre, qui s’immiscent entre Foucault, Derrida, Wittig et Butler, qui les tordent dans tous les sens, qui travaillent à déboulonner les savoirs sur le sexe, qui débusquent les nouvelles technologies du sexe, qui élaborent des contre-savoirs et des contre-pratiques. Une petite mine d’or queer.
Les mille sexes et l’Empire
Les pays industrialisés vivent un véritable devenir-queer : la normativité hétérosexiste éclate sous les assauts des minorités gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles et autres « mauvais genres ». Les droits commencent à apparaître : union civile ou mariage, droits parentaux, bénéfices sociaux, reconnaissance médiatique. Est-ce à dire que la liberté sexuelle se dessine à l’horizon ? On en doutera. Il s’agit peut-être de l’aboutissement du passage, suggéré par Deleuze, de la société disciplinaire à la société de contrôle : les murs des institutions craquent, les identités se fragmentent, les corps sont pénétrés par la technoscience et se mobilisent d’eux-mêmes, bref, à la discipline exercée sur un sujet bien défini et organisé s’est juxtaposé le contrôle souple et invisible d’individus aux identités éclatées.
Revenons un peu en arrière. Les États modernes, capitalistes ou socialistes, ont certes eu besoin d’un dispositif rigide de différence des sexes et d’une normativité hétérosexiste : il fallait transmettre la propriété, reproduire la force de travail, extorquer du travail gratuit aux femmes, assurer la discipline et la stabilité du système et former ses cadres à l'image du chef de la famille patriarcale. La différence des sexes et l’hétéronormativité, et toutes les institutions qui les relaient, famille, mariage, code civil, etc., sont des dispositifs tout à fait modernes qui consistent à enfermer la multiplicité des désirs et des pratiques dans des classes rigides et à produire ainsi des corps et des identités straights. Les identités et pratiques sexuelles hors-normes y sont construites et subordonnées dans le même mouvement.
Ces dispositifs appartiennent à ce que Foucault a appelé le biopouvoir, un ensemble de techniques de gestion de la vie, s’adressant à la population en tant qu’espèce qui doit se reproduire de manière prévisible et contrôlée. Ces techniques s’appuient sur des savoirs sur le sexe développés depuis le 18e siècle, dont Foucault a présenté la genèse dans son Histoire de la sexualité, et que les études féministes, gaies, lesbiennes et queer n’ont eu de cesse de critiquer depuis. Au fondement de ces savoirs, on retrouve l’idée qu’il y a deux sexes et deux genres, complémentaires et incommensurables, d’où découle tout naturellement aussi l’hétéronormativité. Le cas-limite des enfants intersexués illustre bien cette politique : dans les années 50, le Dr John Money et son équipe de l’Université John Hopkins à Baltimore ont développé un ensemble de techniques destinées à transformer en garçon ou en fille des enfants dont les corps comportaient des attributs des deux sexes. Les techniques étaient nombreuses et complexes : chirurgies répétées, hormones, traitement psychologique, le tout dans le but de fabriquer des corps straights et des genres leur correspondant.[4]
Mais les temps ont changé, au point où les corps et les genres straights ne sont peut-être plus aussi nécessaires. En effet, l’entreprise lourde et hiérarchisée a éclaté en mille succursales délocalisées, le travail s’est transformé radicalement, la production est devenue de plus en plus immatérielle, avec comme conséquence que le cadre paternaliste de l’entreprise familiale et le technocrate de la grande entreprise se sont effacés devant le manager de style Mai 68, créatif, dynamique, flexible, célibataire, et, pourquoi pas, femme ou gai. Le capitalisme nouveau genre carbure à l’autonomie, à la souplesse, au réseau ; il devient foucaldien, comme le disent ironiquement Luc Boltanski et Ève Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme. Il peut de plus en plus se passer de la stabilité d’un territoire, d’une famille et d’une identité sexuelle.
Comment l'Empire — c’est le concept construit par Hardt et Negri pour tenter de capter les transformations profondes du capitalisme — fait-il maintenant entrer le sexe dans son jeu ? L’Empire est lui aussi une machine biopolitique. La création de richesses, l'exploitation et la domination s'étendent bien au-delà du travail matériel, jusqu'à la production de la vie elle-même, dans la gestion et la mobilisation des corps et des cerveaux. Le lieu de la production dans l'Empire est un non-lieu : l'espace est celui des communications, de l'informatisation, du marché mondial, un espace sans dehors, sans frontières, où circulent et s’emmêlent humains, animaux et machines. Les biotechnologies ont pris une ampleur hallucinante et la vie elle-même se cote maintenant en bourse.
Là où la société disciplinaire classait, organisait et excluait au nom d’une certaine vérité du sexe, l’Empire module, régule, intègre. Dans plusieurs pays industrialisés, les chartes des droits protègent maintenant l’orientation sexuelle ; les médias, et particulièrement Internet, assurent une visibilité et une diffusion sans précédent aux identités, discours et pratiques des minorités sexuelles ; les psychologues accueillent la diversité sexuelle et l’assurance-santé prend à sa charge les opérations de changement de sexe ; les États règlementent le travail du sexe et la pornographie.
« L’Empire ne norme plus les mille sexes », dit Lazzarato. C’est peut-être aller un peu vite. D’une part, les dispositifs n’ont pas disparu totalement, loin s’en faut ; des dispositifs de contrôle s’y sont plutôt superposés. L’Empire, s’il ne peut plus enfermer les hors-la-loi du sexe comme autrefois, doit quand même faire tenir ensemble ces sujets instables et les fixer minimalement afin que le système se reproduise de manière prévisible. Parmi ces instruments de contrôle figure certainement le mariage gai ou l’union civile. Michael Warner fait remarquer que tant que le mariage existera, l’État voudra contrôler la sexualité des personnes non mariées, restreindre la multiplicité des pratiques sexuelles, limiter l’accès aux publications explicitement sexuelles. Le régime de la sexualité continuera donc à produire des sujets « abjects ».
Le mariage gai est d’ailleurs souvent invoqué comme un moyen pour discipliner les gais et les éloigner des pratiques sexuelles libertaires. Et si le mariage gai met à mal la normalité hétérosexiste, il maintient intact le système de genre et reproduit le modèle de la famille traditionnelle. Même les audacieux députés québécois, qui ont voté la loi 84 permettant aux gais et aux lesbiennes non seulement de s’unir civilement mais d’inscrire leurs deux noms sur l’acte de naissance de leurs enfants, n’ont pas voulu aller plus loin et reconnaître d’autres formes d’arrangements familiaux que celui basé sur le couple et ses enfants. Dans un article paru dans la revue Multitudes (no 20), Chantal Nadeau s’interroge sur les enjeux de la loi 84 dans laquelle des queers ont acquis des droits en échange de la promesse d’une vie vertueuse, à l’enseigne de la famille et de la nation.
Le chantier queer ouvert dans les années 70 par les débordements et les luttes des femmes et des minorités sexuelles était plein de possibilités. Les mondes possibles se sont multipliés certes, mais pas à l’infini. Ils se sont souvent heurtés aux pouvoirs en place et à leur capacité de moduler et de limiter potentiel de multiplicité de la sexualité. Après Stonewall, après la descente du Truxx, une partie de la mouvance queer s’est reterritorialisée : dans les commerces gais, dans la politique, dans la police, dans le mariage, dans la parentalité traditionnelle.
Les puissances de vie de la multitude
Est-ce à dire que la société de contrôle a réduit au silence toutes les puissances d’invention de la sexualité ? Ce serait mal comprendre l’Empire et les forces qui le travaillent que de s’en tenir à un tel constat. Tout dispositif comporte sa part de nouveauté, ses forces de variation, ses lignes de fuite dirait Deleuze. Les nouveaux dispositifs sexuels de la société de contrôle ne font pas exception : dans la répétition et le déploiement des nouvelles normes, des glissements se produisent; des failles se manifestent, les sujet sont sexuellement incohérents, instables. Ils répètent les normes, mais ils répètent mal : jusqu’au point où ces normes se retournent parfois contre le dispositif qu’elles devaient reproduire.
Nous appellerons multitude ces forces de variation. La multitude, c’est le concept que Hardt, Negri, Virno et Lazzarato ont sorti des vieux cartons de Spinoza afin de capter les puissances de vie qui fissurent l’Empire. La multitude, écrivent Hardt et Negri, c'est l'ensemble pluriel constitué par les « subjectivités productives et créatrices de la mondialisation, qui ont appris à naviguer sur cette énorme mer. »
Dans la modernité, encadrée par l'État-nation, la multitude s'était muée en peuple, avec une identité définie, un sentiment d'appartenance, et des frontières la séparant de ceux qu'on avait exclus de la définition de la nation. Dans l'Empire, l'État-nation perd ses prérogatives, les frontières s'ouvrent — de gré ou de force — et la multitude vagabonde refait surface, hybride, éclatée, précaire. Si Hardt et Negri s'intéressent surtout à la multitude créatrice de valeur dans le travail — qu'ils ne réduisent cependant pas au travail matériel ni au travail dit productif —, ils évoquent aussi les nouvelles configurations de sexe et de sexualité en ce qu'elles constituent des déploiements de créativité de la multitude. Entendons-nous : il ne s’agit pas de penser que le travestissement ou le brouillage des genres constituent des pratiques inédites. Ce qui nous intéresse ici est d’un autre ordre : c’est la reconfiguration des rapports que ces pratiques entretiennent avec d’autres ; c’est l’ouverture des possibles que provoque le travesti lorsqu’il enseigne à l’université ou devient la vedette d’une série télévisée :
Les corps eux-mêmes se transforment et mutent pour créer de nouveaux corps « post-humains ». La condition première de cette transformation corporelle est de reconnaître que l'humaine nature n'est en aucune façon séparée de la nature dans sa globalité, qu'il n'y a pas de frontières fixes et nécessaires entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, le mâle et la femelle, et ainsi de suite. C'est la reconnaissance que la nature elle-même est un terrain artificiel ouvert à de nouvelles mutations, à de nouveaux mélange, à de nouvelles hybridations. Non seulement nous subvertissons consciemment les frontières traditionnelles habillés en travesti, par exemple, mais nous nous déplaçons dans une zone au milieu, créative et indéterminée, entre les frontières et sans considération pour elles. (Hardt,Negri,2000 :269)
La multitude queer serait en quelque sorte un monstre qui croît au sein même de l’Empire et que la société de contrôle n’arrive pas à mater. La multitude n’est pas un tout unifié dont les intérêts seraient représentables. La multitude n’est pas totalisable : ses éléments ne seront jamais réconciliés ; même unis dans l’action, leur singularité persiste. Penser la mouvance queer comme une multitude, c’est accepter que jamais nous n’arriverons à décrire la « bonne » totalité queer. Plusieurs s’y sont essayé : après le mouvement gai, il y eut le mouvement des gais et des lesbiennes ; puis Montréal a connu sa Fierté LGBT : lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre. Mais c’est encore réducteur. Chantal Nadeau parle de la sexualité lesbigayqueer ; toujours, une singularité s’échappe et oblige à redéfinir la totalité. La multitude ne se ferme jamais, les singularités prolifèrent. C’est cette idée qu’Eve Sedgwick a tenté de saisir dans sa définition de la planète queer :
[…] la matrice ouverte des possibilités, les écarts, les imbrications, les dissonances, les résonances, les défaillances ou les excès de sens quand les éléments constitutifs du genre et de la sexualité de quelqu’un ne sont pas contraints (ou ne peuvent l’être) à des significations monolithiques. Ce sont les aventures et les expériences politiques, linguistiques, épistémologiques, figuratives que vivent ceux d’entre nous qui aiment à se définir (parmi d’autres possibilités) comme lesbiennes féminines et agressives, tapettes mystiques, fantasmeurs, drag queens et drag kings, clones, cuirs, femmes en smoking, femmes féministes ou hommes féministes, masturbateurs, folles, divas, snap!, virils soumis, mythomanes, transsexuels, wannabe, tantes, camionneuses, hommes qui se définissent comme lesbiens, lesbiennes qui couchent avec des hommes… et aussi tous ceux qui sont capables de les aimer, d’apprendre d’eux et de s’identifier à eux. (Sedgwick1990 :115),
La multitude queer se présente sous les traits de l’Empire : elle est constituée de réseaux, elle ne connaît pas de frontières, Internet est son territoire. Son émergence sur la scène internationale en témoigne : même la Commission des droits humains des Nations Unies a été secouée par une petite tempête queer lorsque le Brésil a proposé d’inscrire l’orientation sexuelle dans les droits reconnus par la Charte.
L’isomorphisme entre la multitude et l’Empire n’empêche pas celle-ci de produire de nouvelles formes de vie. La multitude queer n’échappe pas à la règle. Les dispositifs sexuels de l’Empire, qui vont des lois sur la famille aux règles entourant la pornographie ou la prostitution, produisent sans cesse des corps et des identités abjects qui sont à la fois des effets des régimes de normalisation et des puissances de vie susceptibles de déborder des dispositifs. La multitude recherche la variabilité. Prenons le cas de la loi 84 sur l’union civile.
Si une partie des partisans de la loi 84 étaient à la recherche d’un chez soi confortable et prévisible, tout porte à croire que d’autres utiliseront les possibilités ouvertes par cette loi pour inventer de nouveaux arrangements familiaux, de nouveaux mode de procréation, de nouvelles constructions identitaires. Les nouveaux agencements comme ceux mis en place par la loi 84 comportent une part d’imprévisible et de risqué. Déjà, les familles à quatre parents ont fait leur apparition : deux gais et deux lesbiennes procréent et élèvent ensemble un ou des enfants. L’ordre procréatif pourrait être mis à mal lui aussi : Marie-Blanche Tahon n’évoque-t-elle pas le spectre de la mère porteuse, puisque ça serait la seule manière de rétablir l’égalité entre les gais et les lesbiennes face à la procréation ?
Et si l’audace des députés québécois a ouvert une brèche dans la loi sur l’État civil en autorisant l’inscription de deux mères ou de deux pères, on peut penser que certains voudront prolonger le mouvement et carrément faire sauter l’identité sexuelle de l’état civil. Ce serait là un coup solide au dispositif de la différence des sexes et de l’hétéronormativité.
La multitude queer n’est donc ni le simple avatar des régimes de normalisation, ni l’expression d’une identité stable ou d’une communauté bien définie qu’elle aurait pour mission de représenter. La multitude queer est monstre, projet, débordement, variation, fuite. Quelle est alors sa politique ?
Ce n’est pas celle de la représentation. Puisqu’elle n’est pas totalisable, elle peut difficilement être un corps politique unifié. Le parti queer, ça n’est pas son genre. La politique queer, on peut l’envisager comme un exode, une échappée hors des techniques de contrôle de la nouvelle normalité queer : on la pratique dans les bars mal famés, dans les parcs des grandes villes quand le soir tombe, chez les queers marginalisés dans leurs communautés ethniques, dans la transformation des corps dans l’art et la vidéo, dans le brouillage des identités sur le net ; chez les travailleurs et travailleuses du sexe ; chez les androgynes, les gouines, les drag kings, les trans, les cuirs, les bears et autres « mauvais sujets ».
Faire de la politique en tant que multitude queer est un défi : il faut sortir non seulement du dispositif hétéronormatif, mais de la différence des sexes elle-même, multiplier les identités, faire proliférer les arrangements, créée des espaces communs non étatiques, fussent-ils provisoires et précaires. Les stratégies sont nombreuses : Preciado évoque la dés-identification : elle voit dans la lesbienne qui n’est pas une femme de Wittig une tentative de déjouer la binarité sexuelle ; les féministes post-structuralistes ont suivi une voie similaire : de Braidotti à Haraway, en passant par de Lauretis et plusieurs autres, le but a toujours été le même : sortir de la représentation de la femme et entrer dans le devenir-femme, la femme-projet, la nomade, le cyborg, la femme inscrite sur une ligne de fuite par rapport au dispositif de la différence des sexes et de l’hétéronormativité. On pourrait dire la même chose des femmes qui se masculinisent ou des hommes qui se féminisent, par les hormones et d’autres artifices, qui travestissent les signes, juste assez pour brouiller les pistes.
On peut multiplier les exemples , l’exode et la déterritorialisation de l’espace ou du corps font partie des stratégies de la multitude : le devenir-queer de certains quartiers, la manipulation des corps dans la vidéo et l’Internet sont autant de manière de créer de nouvelles formes de vie. La désobéissance et l’impertinence sont également au programme : en accueillant les délégués au congrès conservateur avec une petite tape sur la fesse et un baiser, les Panthères roses troublent délicieusement l’ordre sexuel.
La lutte pour les droits n’est pas exclue pour autant de la politique de la multitude. Là où les États ne garantissent pas les droits — et c’est le cas dans la majorité des pays —, la lutte pour l’égalité est essentielle, bien que limitée. La résolution brésilienne évoquée précédemment est en ce sens importante. Mais Lazzarato précise le sens de cette lutte : « Nous voulons des droits pour devenir autre chose » écrit-il, et non « nous voulons ceci parce que nous sommes cela ». La multitude est en ce sens à la fois dehors et dedans ; hors-la-loi à ses heures et revendicatrices à d’autres, elle cherche les échappées.
La politique de la multitude queer consiste à garder l’œil ouvert dans la mesure où les nouveaux dispositifs, fruits des luttes et des mobilisations, sont toujours des paradoxes. La loi 84 est ici encore un bon exemple : si d’aucuns y voient une fermeture du champ des possibles, un repli sur la tradition, une nouvelle ligne d’exclusion, il n’en demeure pas mois que cette loi ouvre un champ d’expérimentation dont nous mesurons encore mal l’ampleur. Dans son pamphlet contre la loi, Marie-Blanche Tahon l’a clairement vu.
Les queers comme multitude pratiquent une politique sans sujet unifié, une politique de la multiplicité, une multiplicité qui subsiste comme telle dans l’action et ne s’efface jamais dans l’intérêt commun. Au lieu de planifier, la multitude expérimente. Loin de l’humanisme républicain et de son citoyen abstrait, loin de la communauté aussi, fut-elle gai, lesbienne, féministe ou queer, la multitude fomente la fin de la représentation politique. Avec la multitude, nous disons non pas « un autre monde est possible », mais « multiplions les mondes possibles ».
Utopie, chimère, délire ? Les objections seront nombreuses à cette célébration de la multitude, à gauche particulièrement. Je commence à avoir du mal à m’enthousiasmer pour cette gauche, empêtrée comme elle est dans d’interminables débats pour forger son illusoire unité, ciment d’un futur parti ; comme si elle n’avait pas vu que les puissances de vie ne pouvaient plus être contenues, que l’Empire lui-même a renoncé à la discipline et à la stabilité.
Références bibliographiques
BOURCIER, Marie-Hélène. Sexpolitiques. Queer zones 2. Paris : La fabrique, 2005.
_________ Queer zones, Paris, Balland, 2001.
BRAIDOTTI, Rosi. Nomadic Subjects. New York : Columbia University Press, 1994.
BROSSARD, Louise. Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité et les rapports sociaux de sexe : Rich, Wittig, Butler. Montréal : Institut de recherches et d’études féministes, Les Cahiers de l’IREF, no 14, 2005.
BUNCH, Charlotte et Claudia HINOJOSA (dir.). Lesbians travel the Road of Feminism Globally. New York : Rutgers University, Center for Women Global Leadership, 2000.
BUNCH, Charlotte. Passionate Politics. New York : St. Martin’s Press, 1987.
BUTLER, Judith. Défaire le genre. Paris : Éditions Amsterdam, 2006.
________ Humain, inhumain. Paris : Éditions Amsterdam, 2005.
________ Le pouvoir des mots. Politique du performatif. Paris : Éditions Amsterdam, 2005.
________ Trouble dans le genre. Paris : Éditions La découverte, 2005.
________ « Critically Queer » dans Shane Phelan (dir.), Playing with Fire. Queer Politics, Queer Theorie., Londres et New York : Routledge, 1997.
CRUZ-MALAVÉ, Arnaldo et Martin MANALANSAN (dir.). Citizenship and the Afterlife of Colonialism, New York, NYU Press, 2002.
DEMCZUK, Irene et Frank REMIGGI. Sortir de l’ombre, histoire des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal : VLB éditeur, 1998.
FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité. Vol 1. La volonté de savoir. Paris : Gallimard, 1976.
HARAWAY, Donna. Modest_Witness@Second_Millenium. New York : Routledge, 1995.
HARDT, Michael et Antonio NEGRI. Empire. Paris : Exils, 2000.
________ Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’empire. Montréal : Boréal, 20054.
HIGGINS, Ross. De la clandestinité à l’affirmation : pour une histoire de la communauté gaie montréalaise. Montréal : Comeau et Nadeau, 1999.
hooks, bell. Ain’t I a Women ? Black Women and Feminism. Boston : South End Press, 1981.
KOSOFSKY SEDGWICK, Eve. Epistemology of the Closet. Berkeley : Univertsity of Columbia Press, 1998.
LAMOUREUX, Diane (dir.). Les limites de l’identité sexuelle. Montréal : Les Éditions du Remue-ménage, 1997.
LAZZARATO, Maurizio. Les révolutions du capitalisme. Paris : Les empêcheurs de tourner en rond, 2004.
LORDE, Audrey. Sister Outsider. Trumansburg (NY) : Crossing Press, 1984.
MATHIEU, Nicole-Claude et al. L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes. Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1985.
MORAGA, Cherrie et Gloria ANZALDÚA. This Bridge Called my Back. Writings by Radical Women of Color. New York : Third Women Press, 2001 (1ère édition 1983, The Kitchen Table Press).
PRECIADO, Beatriz. Manifeste contra-sexuel. Paris : Balland, 2000.
RICH, Adrienne. « Contrainte à l’hétérosexualité et existence lesbienne ». Paris : Nouvelles questions féministes, n° 1, 1981, p. 32.
VIRNO, Paolo. Grammaire de la multitude. Nîmes et Montréal : Éditions de l’Éclat et Conjonctures, 2002.
WARNER, Michael. The Trouble with Normal. Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life. New York : The Free Press, 1999.
WITTIG, Monique. La Pensée straight. Paris : Balland, 2001 (paru en anglais en 1992).
Notice biographique
Colette St-Hilaire enseigne la sociologie au Collège Édouard-Montpetit
(Longueuil, Québec, Canada). Elle est membre du collectif de rédaction
de la revue Conjonctures, une revue indépendante d’analyse
[1] Ce texte a paru dans la revue québécoise Conjonctures, no 41/42, 2006.
[2] Je devrais ajouter « les pédophiles », mais quelque chose me retient. Une ultime frontière peut-être.
[3] Voir les textes de Line Chamberland, Anick Druelle et Roberto Jovel dans le numéro 41/42 de Conjonctures.
[4] Ces cas sont nombreux et complexes ; ils ont suscité des débats passionnés. Pour une analyse de ces enjeux et une critique de l’approche de John Money, voir Judith Butler. Undoing Gender. New York : Routledge, 2004, ch. 3, et Ann-Fausto-Sterling. Sexing the Body. New York : Basic Books, 2000, ch. 3.
![]()
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007