
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2008-janeiro/junho 2008
Le télétravail et le travail mobile :
des différences hommes-femmes ?
Laurence Thomsin et Diane-Gabrielle Tremblay
Résumé
Le télétravail est souvent présenté comme un avantage du point de vue de la conciliation des activités professionnelles et familiales mais on le présente souvent comme un avantage concernant surtout les femmes. Or, bien que ce soit généralement les femmes qui soient responsables de ces activités familiales et parentales, nous avons voulu déterminer si c’est le fait d’être une femme ou le fait d’avoir des enfants qui explique davantage que l’on pratique le télétravail, ou travail mobile. Nous avons pu réaliser une enquête auprès d’une grande entreprise belge et avons pu réaliser une étude très approfondie du télétravail dans cette organisation. Les données confirment qu’il est intéressant de voir les choses plus largement que la conciliation comme avantage du télétravail pour les femmes, et de considérer que les hommes avec enfants peuvent aussi être intéressés par cette pratique du travail mobile. Nos données permettent de confirmer que ce n’est pas tant le sexe (le fait d’être une femme) qui explique le recours au télétravail, mais le fait d’avoir des enfants. Ceci ouvre des pistes de recherche intéressantes pour de futures études sur le télétravail et le travail mobile.
Mots-clé: télétravail, femmes, conciliation
1. Introduction
Le télétravail suscite beaucoup d’intérêt depuis quelques années, notamment dans la perspective de réduire les déplacements et la consommation de pétrole, ainsi que la pollution qui s’ensuit dans un contexte où nombre de pays se trouvent confrontés à des problèmes de congestion urbaine (Benchimol, 1994), mais aussi de plus en plus des raisons de qualité de vie, de meilleure organisation du travail personnel et de conciliation entre les activités personnelles et professionnelles, ou conciliation emploi-famille (Tremblay, 2002 ; Tremblay, Paquet et Najem, 2006). C’est pourquoi nombre de travaux semblent indiquer que les femmes seraient plus intéressées par le télétravail que les hommes, d’autant plus que ces derniers peuvent avoir des ambitions de carrière plus importantes, qui les inciteraient à rester visibles au bureau.
Le télétravail, que l’on appelle parfois le travail mobile ou le « mobile working » est d’autant plus l’objet d’attention depuis que les TIC permettent de travailler à peu près partout, soit « here, there, anywhere and anytime », comme le soulignent Kurkland et Bailey (1999). Il semble toutefois que ce soit des problèmes d’articulation des temps sociaux, et plus particulièrement d’articulation des temps personnels et professionnels qui puissent expliquer la hausse du télétravail (Baines et Gelder, 2003; Duxbury et Higgins, 2003) et bien que l’on sache que les femmes sont les principales responsables des activités familiales et parentales, peu de recherches permettent de savoir si effectivement les femmes utilisent davantage le télétravail pour faciliter la conciliation de ces activités. De plus, si l’on observe une certaine augmentation de la pratique du télétravail et du travail mobile, on connaît mal les motifs qui expliquent le recours au télétravail, ou les caractéristiques individuelles qui permettent d’expliquer la fréquence du télétravail ou son absence dans des groupes ou chez des individus donnés.
C’est dans cette perspective que nous avons voulu étudier les liens entre la pratique du travail mobile et diverses caractéristiques individuelles, dont le fait d’être une femme, ou encore d’avoir des enfants, et nous demander en particulier si les femmes pouvaient profiter davantage de cette option pour faciliter la conciliation de leurs activités personnelles, familiales et professionnelles.
Nous avons pu réaliser une enquête dans une grande entreprise multinationale, établie en Belgique, qui favorise le télétravail et le travail mobile; c’est ainsi que l’organisation qualifie le programme, car il ne s’agit pas seulement de la forme classique du télétravail, généralement réalisé à domicile, mais aussi de divers lieux possibles de travail (chez le client, dans des bureaux satellites, télécentres, etc.), ce qui correspond aux nouvelles réalités du télétravail, dont les formes se sont diversifiées.
Dans cet article, nous présentons d’abord la problématique de recherche, incluant les définitions des concepts de télétravail et concepts apparentés, puis nous nous intéressons à la problématique de la conciliation emploi-famille et des avantages potentiels du télétravail à cet égard. Ensuite, nous exposons certains des résultats obtenus dans cette recherche, en nous intéressant surtout à la dimension « genre », à savoir si ce sont les femmes, ou la présence d’enfants (et les responsabilités parentales qui y sont associées) qui suscitent la pratique du télétravail ou non.
2. Problématique de recherche
Il faut souligner que le télétravail recouvre des réalités très diverses et c’est pourquoi l’appellation de travail mobile est peut-être intéressante, parce que plus large. L’expression anglaise de « mobile work » est utilisée dans l’organisation enquêtée, mais on peut la traduire par « travail mobile » si on souhaite insister davantage sur la diversité des lieux de travail, parfois pour un seul individu. Le télétravail fait habituellement référence au travail à distance du siège principal de l’employeur, avec utilisation de lien internet, mais certains télétravailleurs ou « mobile workers » n’ont pas accès au lien internet, bien que cela constitue un facteur important de participation au télétravail.
Les études réalisées à ce jour permettent de distinguer divers modes de télétravail, outre le travail à domicile, et le travail mobile est certes l’une des formes qui est en progression importante. En effet, certains considèrent le travail en centres d’affaires délocalisé ou le bureau satellite réunissant les employés d’une même entreprise comme une forme de télétravail ou de travail mobile. On peut inclure aussi les centres d’appel, où les téléphonistes sont regroupées en un lieu distinct de l’organisation qui les emploie.
Certains incluent également le travail mobile réalisé en divers endroits hors du bureau (vendeurs, techniciens, etc.), ainsi que le télécentre ou télécottage, réunissant les employés de plusieurs entreprises, voire même le travail à l’hôtel, qui a d’ailleurs été considéré dans l’enquête présentée ici. Certains considèrent aussi que les personnels de vente et de représentation qui sont généralement chez des clients, mais travaillent parfois à domicile, sans avoir d’autre bureau au sein de l’organisation qui les emploie, sont aussi des télétravailleurs. On aurait ainsi trois grands groupes de télétravailleurs ou de travailleurs mobiles si l’on se base sur le lieu de travail : les télétravailleurs à domicile, les télétravailleurs qui sont habituellement chez des clients, et ceux qui travaillent dans des centres d’affaires délocalisés ou télécentres.
La diversité des définitions rend difficile la quantification du phénomène du travail mobile, comme du télétravail. Plus la définition est large, plus on comptabilisera un nombre important de télétravailleurs dans un pays donné (Felstead et Jewson , 2000). Les taux restent malgré tout assez faibles, entre 2 et 7 %, alors qu’on note que l’intérêt des individus et des organisations pour le télétravail est beaucoup plus élevé (tableau 1).
Tableau 1. Pourcentage de télétravailleurs dans divers pays européens et intérêt pour le télétravail des individus et organisations
|
Pays |
% de télétravailleurs |
intérêt pour le télétravail des individus |
intérêt des organisations à développer le télétravail |
|
Grande-Bretagne |
7.4% |
43.5% |
34.4% |
|
France |
7.0% |
49.8% |
39.3% |
|
Allemagne |
4.8% |
40.5% |
40.4% |
|
Espagne |
3.6% |
54.6% |
29.6% |
|
Italie |
2.2% |
45.4% |
41.8% |
Source : Benchimol (1994) repris dans Tremblay (2006).
Plusieurs études notent que la conciliation emploi-famille serait l’un des objectifs de la pratique du télétravail (Baines et Gelder, 2003; Duxbury et Higgins, 2003) Certaines études, dont celle de Christensen (1987) et celle de Felstead et Jewson (2000), indiquent que le télétravail peut engendrer un conflit entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales ou personnelles, en raison de la présence de matériel de travail dans la maison et du fait que les membres de la famille peuvent interrompre le travail, lorsque celui-ci est pratiqué à domicile. Cependant, Tremblay (2003) ne fait état que de problèmes mineurs d’adaptation au début de l’installation à la maison et ses résultats indiquent que les participants considèrent que les avantages compensent largement pour les inconvénients. Enfin, d’autres études indiquent que c’est surtout en raison des obligations du travail lui-même que les gens apportent du travail à la maison et font du télétravail (Tremblay, Paquet et Najem, 2006).
Certaines recherches indiquent que l’absence de collègues vient au premier rang des inconvénients, surtout pour les personnes qui sont à temps plein à domicile, et les femmes seraient un peu plus nombreuses que les hommes à considérer l’absence de collègues de travail comme le premier inconvénient du télétravail (Tremblay, 2001). Certains considèrent aussi l’isolement ou le fait de travailler davantage ou trop comme un autre inconvénient. Le fait de travailler trop ou davantage ne semble pas un problème majeur selon Tremblay (2001), bien qu’il apparaisse dans certaines études sur le télétravail. Certains télétravailleurs indiquent avoir plus de difficulté à se motiver ou se discipliner lorsqu’ils travaillent à domicile, et d’autres font état de conflits entre le travail et la famille. Ainsi, Felstead et Jewson (2000) font état de tels problèmes liés à la difficulté d’établir des frontières entre le travail, la famille, les loisirs, et ce, sur les plans temporel et spatial. Cependant, bon nombre de personnes semblent s’adapter assez rapidement à ces nouveaux repères et arrivent à cloisonner leurs activités.
Il est donc intéressant d’approfondir la question puisque les résultats obtenus à ce jour sont partagés et que peu d’études portaient sur des organisations où le télétravail ou le « mobile work » est une pratique très répandue, ce qui est le cas de l’organisation étudiée ici, qui favorise cette pratique par une politique formelle à cet égard. Le fait d’en faire une pratique formelle peut modifier considérablement la pratique et faciliter la participation, mais il reste à voir si hommes et femmes peuvent effectivement avoir recours à cette modalité de travail, ou si d’autres contraintes apparaissent, qui peuvent limiter la participation.
3. Méthodologie
Les résultats présentés ici sont issus d’une enquête menée en Belgique, dans une grande organisation du domaine des technologies de l’information. Compte tenu de l’accord cadre sur le télétravail adopté en Europe, il était intéressant de voir comment se pratique le télétravail concrètement en étudiant une organisation. Cette enquête a été menée en 2005 et portait sur ce qu’il a été convenu d’appeler le « mobile working », soit une définition assez englobante du télétravail, qui inclut la possibilité que les télétravailleurs se trouvent chez le client,ou ailleurs que dans l’entreprise, et l’on s’est intéressé plus particulièrement aux enchaînements de lieux de travail que vivent ces populations. Ceci est intéressant puisque l’on considère que le travail mobile (en divers lieux) a eu tendance à s’accroître au cours des dernières années (Kurkland et Bailey,1999), mais que peu d’enquêtes ont permis d’en mesurer aussi précisément le contenu.
Le taux de participation à l’enquête, intitulée « Mobile Working Survey », est de 35.79% pour l’ensemble de l’entreprise étudiée (1343 réponses pour 3752 sondés). Le tableau ci-dessous présente le taux de réponse pour chacune des quatre groupes considérés. Les individus ont été associés à la catégorie « télétravailleurs » ou « sédentaires » selon qu’ils disposaient ou non d’une connexion Internet mise à disposition par l’organisation.
Tableau 2. La population enquêtée
|
|
|
Réponses |
Individus |
Taux de participation |
|
Groupe
|
Télétravailleurs Collaborateurs (Gr 1) |
827 |
2102 |
39.34 |
|
Télétravailleurs Coachs (Gr 2) |
111 |
319 |
34.80 |
|
|
Sédentaires Collaborateurs (Gr 3) |
385 |
1263 |
30.48 |
|
|
Sédentaires Coachs (Gr 4) |
19 |
68 |
27.94 |
Les données concernant la première participation au « mobile working » montrent que cette pratique s’est surtout généralisée à partir de l’an 2000, et que peu de gens avaient commencé à le pratiquer avant 1995. La tendance s’est toutefois fortement intensifiée depuis l’an 2000, puisqu’environ les deux tiers des salariés la pratiquent aujourd’hui.[1]
Il est intéressant de noter qu’un quart des répondants travaillent dans la région de Bruxelles, alors que 42 % sont basés à Huizigen, et 22 % sont basés à Herentals, soit un peu à l’extérieur de Bruxelles et du siège principal de l’organisation. Il est aussi intéressant de noter que sur l’ensemble, 28 % n’ont pas de bureau fixe au siège d’affectation, que 52 % jouissent d’une voiture de fonction. On observe aussi que 78 % sont des hommes , mais qu’il y a tout de même près de 22 % de femmes. Par ailleurs, la majorité des répondants a entre 25 et 44 ans (73 %) et est marié (66 %). Autre variable importante pour notre problématique, étant entendu que la conciliation emploi-famille ne se limite pas aux femmes, on observe aussi que 68 % des répondants ont des enfants.
Tableau 3. Les conditions de travail
| Bureau fixe au siège d’affectation |
Oui |
957 |
71.31 |
|
Non |
85 |
28.69 |
|
|
Voiture de fonction |
Oui |
705 |
52.53 |
|
Non |
637 |
47.47 |
|
|
Sexe |
Masculin |
1051 |
78.32 |
|
Féminin |
291 |
21.68 |
|
|
Age |
<25 |
17 |
1.27 |
|
25-34 |
438 |
32.64 |
|
|
35-44 |
558 |
41.58 |
|
|
45-54 |
263 |
19.60 |
|
|
>54 |
66 |
4.92 |
|
Situation matrimoniale |
Célibataire |
212 |
15.80 |
|
Marié |
890 |
66.32 |
|
|
Cohabitant |
169 |
12.59 |
|
|
Séparé |
22 |
1.64 |
|
|
Divorcé |
42 |
3.13 |
|
|
Remarié |
4 |
0.30 |
|
|
Veuf |
3 |
0.22 |
|
Enfants |
Oui |
925 |
68.93 |
|
Non |
417 |
31.07 |
En ce qui concerne les fonctions, on observe que ce sont surtout des employés ayant des fonctions techniques (près de 21 %) et des cadres-experts (que l’on peut apparenter aux professionnels dans la terminologie nord-américaine) qui profitent de cette situation, de sorte que les femmes sont moins présentes, mais il reste malgré tout intéressant de voir si les femmes utilisent davantage la mesure, ou si les personnes avec enfant l’utilisent davantage, puisque ce devrait théoriquement être le cas, si l’on se fie à certains travaux indiquant que le travail mobile ou télétravail peut favoriser la conciliation (pas besoin d’aller au bureau central, ou de repasser au bureau après les rencontres avec les clients).
Graphique 1. Les fonctions des répondants
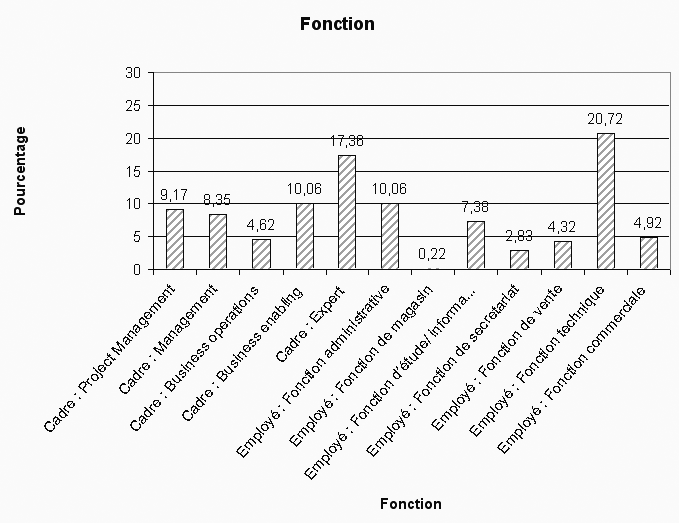
Il est intéressant de voir dans quelle mesure hommes et femmes sont équipés pour pratiquer le télétravail ou « mobile working ». Le graphique 2 présente, pour les hommes ainsi que les femmes, les pourcentages relatifs à la possibilité technique de pratiquer le « mobile working », à savoir l’existence d’une connexion mise à disposition ou non par l’entreprise. On observe que les pourcentages sont très différents selon le sexe, ce qui vient confirmer les observations d’autres travaux en ce qui concerne la différenciation selon le sexe des conditions de la pratique du télétravail (Tremblay, 2001). En effet, on constate ici que plus de 75% des hommes ont la possibilité de pratiquer le « mobile working » alors que moins de la moitié de la population féminine bénéficie de cette possibilité, du moins si celle-ci est liée à l’existence d’une connexion, ce qui est généralement le cas, et notamment dans cette entreprise. Ceci est possiblement en partie dû aux fonctions assumées par les uns et les autres, mais n’en reste pas moins intéressant à observer, puisque cela traduit une évolution différenciée du mode de travail chez les hommes et les femmes.
Graphique 2. Possibilité technique de faire du travail mobile, selon le sexe
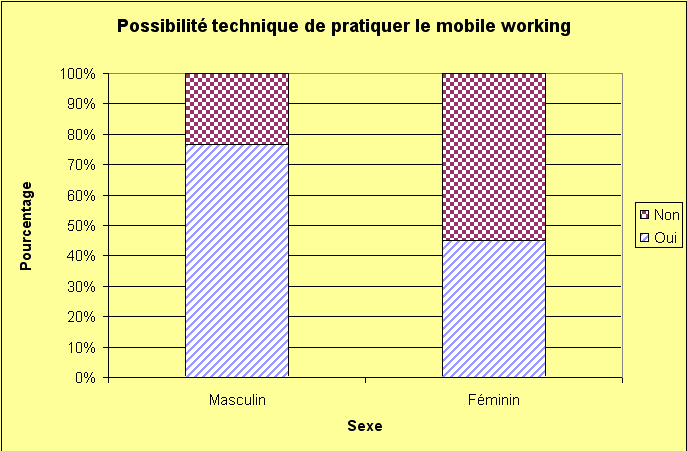
Nous avons aussi étudié, pour chaque tranche d’âge, les pourcentages relatifs à la possibilité technique de pratiquer le « mobile working ». En dehors de la classe des moins de 25 ans, la proportion de personnes ayant la possibilité de pratiquer le travail mobile est supérieure à 50%. Cette proportion est même supérieure à 70% chez les 35-44 ans.
Nous nous sommes aussi intéressés à différentes fonctions, et aux pourcentages relatifs à la possibilité technique de pratiquer le travail mobile. Pour la majorité des fonctions, la proportion d’individus ayant la possibilité de pratiquer le mobile est supérieure à celle des sujets n’ayant pas cette possibilité. Les proportions d’individus ayant cette possibilité sont toutefois inférieures chez les employés ; les pourcentages relatifs aux fonctions administratives et de secrétariat sont inférieurs à 30% et l’on sait que cette catégorie regroupe un bon pourcentage de femmes. Ceci est un peu étonnant, car on pourrait penser que les développements technologiques permettraient aux fonctions administratives et secrétariales de s’exercer à domicile, alors que ce ne semble pas être le cas.
Ceci mériterait approfondissement, pour déterminer si ce sont des problèmes techniques, ou plutôt une vision traditionnelle de la fonction de secrétariat, le désir des supérieurs d’avoir les femmes présentes au bureau, qui explique cette réalité. Nous n’avons pu le déterminer dans cette enquête, mais cela pourrait être analysé dans l’avenir, car il est clair qu’outre la fonction de magasin, où l’on comprend qu’il soit difficile voire impossible de faire du télétravail, la fonction de secrétariat est celle où c’est le plus rare, ce qui est tout de même étonnant.
Graphique 3. Possibilité technique de faire du travail mobile, selon la catégorie professionnelle
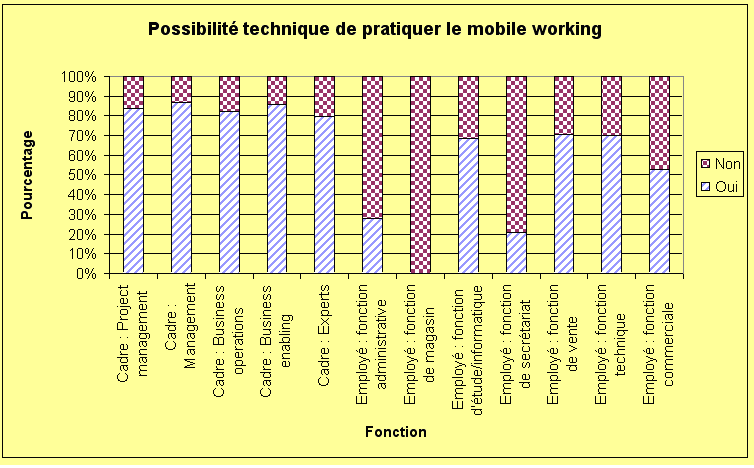
Les données ci-dessous présentent les fréquences et pourcentages de réponses relatives aux populations télétravailleuses. Parmi les individus ayant la possibilité technique de télétravailler (groupes 1 et 2) , 82,2% pratiquent effectivement une forme au moins de travail mobile La proportion de sujets pratiquant réellement le mobile working est de 24,5% chez les individus ne disposant pas d’une connexion Internet, ce qui signifie que la connexion n’est pas nécessaire pour toutes les formes de travail mobile.
Tableau 4. Conditions de travail des personnes faisant du travail mobile
|
|
|
Gr. 1 & 2 |
Gr. 3 &4 |
||
|
|
|
Fréq. |
% |
Fréq. |
% |
|
Participation à une forme (même) partielle de mobile working |
Oui |
771 |
82.20 |
99 |
24.50 |
|
Non |
167 |
17.80 |
305 |
75.50 |
|
Note : les groupes 1 et 2 représentent les personnes ayant la possibilité technique de télétravailler, les 3 et 4 représentent ceux qui n’ont pas cette possibilité technique, mais peuvent tout de même le faire, sans les technologies.
|
Sexe |
Masculin |
807 |
86.03 |
244 |
60.40 |
|
Féminin |
131 |
13.97 |
160 |
39.60 |
| Enfants |
Oui |
666 |
71.00 |
259 |
64.11 |
|
Non |
272 |
29.00 |
145 |
35.89 |
Il est intéressant de noter ici l’importance du pourcentage de personnes qui ont des enfants et pratiquent le télétravail ou travail mobile. Il semble bien que la présence d’enfants est fréquente chez les personnes pratiquant le travail mobile. Des analyses statistiques plus poussées nous permettent, dans les paragraphes qui suivent, de voir si effectivement la variable sexe ou présence d’enfants est déterminante, ce que nous avons souhaité vérifier.
Sexe
Nous nous sommes demandé si le fait de pratiquer effectivement une forme au moins de travail mobile est significativement lié au sexe et c’est effectivement le cas (p<.0001) ; cependant, à notre étonnement, les hommes le pratiquent nettement plus que les femmes.
Le tableau ci-dessous présente, pour les hommes ainsi que les femmes, les fréquences et pourcentages relatifs à la participation (à une forme au moins) de travail mobile. On y constate que les femmes participent, en pourcentage, moins que les hommes, qui sont par ailleurs plus nombreux dans l’organisation.
Tableau 5. Pratique du travail mobile en fonction du sexe
|
Sexe |
Pratique du travail mobile |
|||
|
Oui |
Non |
|||
|
Fréquence |
Pourcentage |
Fréquence |
Pourcentage |
|
|
Masculin |
742 |
70.60 |
309 |
29.40 |
|
Féminin |
128 |
43.99 |
163 |
56.01 |
Les pourcentages relatifs à la participation au travail mobile sont très différents selon le sexe. En effet, plus de 70% des hommes pratiquent une forme au moins de travail mobile alors que la proportion de femmes pratiquant effectivement le travail mobile est d’environ 44 %. Les deux derniers éléments sont sans doute liés, les femmes étant concentrées dans certaines fonctions (secrétariat notamment) où cela se pratique moins, alors que les hommes sont plus souvent cadres, employés en informatique ou dans une fonction technique.
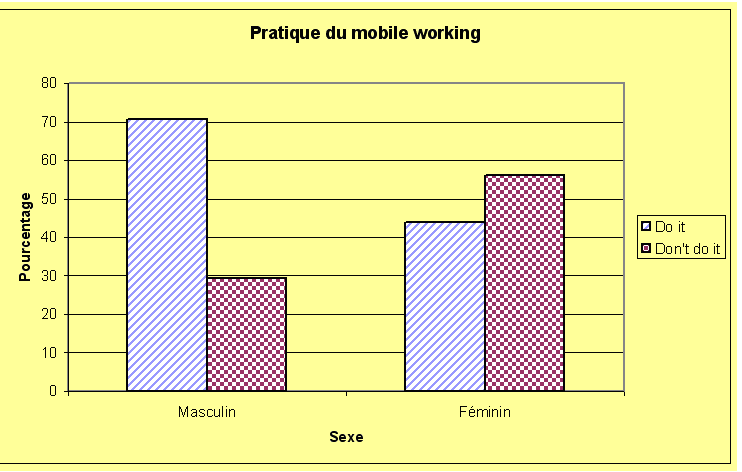
Comme nous l’avons indiqué plus haut (Duxbury et Higgins, 2003 ; Baines et Gelder, 2003) le télétravail est parfois vu comme un avantage du point de vue de la conciliation des activités professionnelles et familiales (dont responsabilités liées aux enfants). Bien que ce soit généralement les femmes qui soient responsables de ces activités, il est intéressant de voir les choses plus largement et de considérer que les hommes avec enfants peuvent aussi être intéressés par cette pratique du travail mobile. De ce fait, il est très intéressant de noter que le fait de pratiquer effectivement une forme au moins de travail mobile est significativement lié au fait d’avoir des enfants (p=0.0039). Le tableau 6 présente les pourcentages relatifs aux différentes classes engendrées par le croisement de ces deux variables et montre que les personnes avec enfants pratiquent le travail mobile beaucoup plus que les autres, plus du double du pourcentage des personnes sans enfant.
C’est certes là un résultat intéressant, qui montre que la présence d’enfants peut accroître l’intérêt pour le télétravail et travail mobile, de sorte que l’on peut conclure qu’au-delà de l’intérêt présumé des femmes pour cette forme de travail, c’est peut-être davantage la présence d’enfants qui rend cette pratique intéressante pour les salariés.
Tableau 6. Répartition du travail mobile selon la présence d’enfants
|
|
Pratique du mobile working |
||
|
Oui |
Non |
||
|
Oui |
46.42 |
22.50 |
|
|
Non |
18.41 |
12.67 |
|
Le tableau 7 présente, pour les personnes ayant des enfants ainsi que ceux sans, les fréquences et pourcentages relatifs à la participation (à une forme au moins) de travail mobile.
Tableau 7. Pratique du travail mobile selon la présence d’enfants
|
Enfants |
Pratique du mobile working |
|||
|
Oui |
Non |
|||
|
Fréquence |
Pourcentage |
Fréquence |
Pourcentage |
|
|
Oui |
623 |
67.35 |
302 |
32.65 |
|
Non |
247 |
59.23 |
170 |
40.77 |
Le pourcentage relatif à la participation au travail mobile est plus élevé chez les individus ayant des enfants que chez les autres, mais on peut se demander si d’autres aspects peuvent être en cause, et nous nous sommes intéressées à la fonction occupée par ces personnes.
La fonction a aussi été parfois citée comme facteur explicatif de la possibilité de travailler à distance ou en mobilité (Cefrio, 2001 ; Tremblay, Paquet, Najem, 2006). Le fait de pratiquer une forme au moins de « mobile working » est significativement lié à la fonction (p<.0001).
Le graphique et le tableau 8 présentent, pour chacune des différentes fonctions, les fréquences et pourcentages relatifs à la participation (à une forme au moins) de travail mobileLes proportions de télétravailleurs sont, en général, plus élevées pour les fonctions de cadre (plus masculines) que d’employés (plus féminines). Ce sont pour les fonctions administratives et de secrétariat, soit les catégories plus féminines, que ces proportions sont les plus faibles, ce qui est quelque peu paradoxal puisque l’on sait que ce sont les femmes qui assument le plus de responsabilités familiales, mais compte tenu de leurs fonctions subalternes (secrétariat et soutien administratif), elles ont apparemment moins la possibilité de pratiquer le travail mobile ou télétravail.
Tableau 8. Pratique du travail mobile selon la fonction
|
Fonction |
Pratique du travail mobile |
|||
|
Oui |
Non |
|||
|
Fréquence |
Pourcentage |
Fréquence |
Pourcentage |
|
|
Cadre : Project management |
104 |
84.55 |
19 |
15.45 |
|
Cadre : Management |
92 |
82.14 |
20 |
17.86 |
|
Cadre : Business operations |
51 |
82.26 |
11 |
17.74 |
|
Cadre : Business enabling |
120 |
88.89 |
15 |
11.11 |
|
Cadre : Experts |
149 |
63.95 |
84 |
36.05 |
|
Employé : fonction administrative |
38 |
28.15 |
97 |
71.85 |
|
Employé : fonction de magasin |
0 |
0.00 |
3 |
100 |
|
Employé : fonction d'étude/informatique |
59 |
59.60 |
40 |
40.40 |
|
Employé : fonction de secrétariat |
8 |
21.05 |
30 |
78.95 |
|
Employé : fonction de vente |
43 |
74.14 |
15 |
25.86 |
|
Employé : fonction technique |
167 |
60.07 |
111 |
39.93 |
|
Employé : fonction commerciale |
39 |
59.09 |
27 |
40.91 |
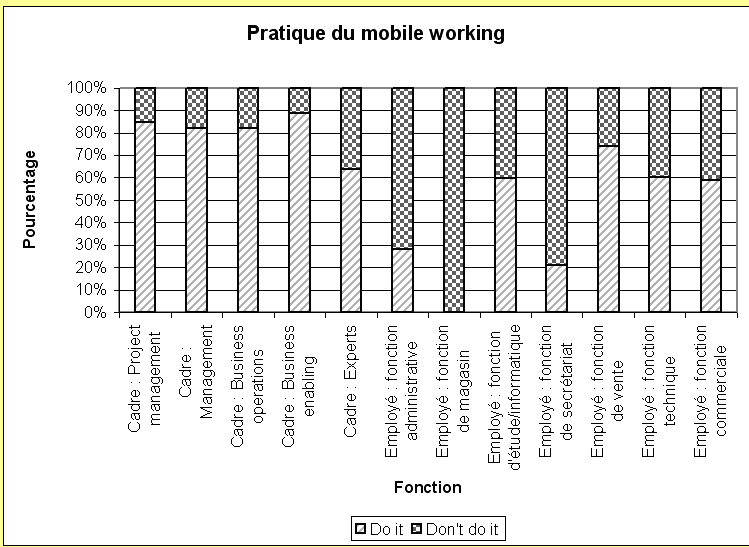
Il semble donc que les femmes n’ont pas la possibilité de participer au télétravail ou travail mobile autant que les hommes, puisqu’elles ne sont apparemment pas dans les fonctions où cela est généralement prévu. Par contre, la présence d’enfants semble avoir un effet, comme nous l’avons vu plus haut. D’autres questions portaient sur les avantages du télétravail et travail mobile et permettent de voir si la conciliation emploi-famille peut être jugée une variable importante. Le graphique A présente la moyenne des scores d’importance et de satisfaction attribués aux différents apports de mobile working par les populations « télétravailleuses » (groupes 1 et 2). L’indice de satisfaction globale, dit SQI ici, est également donné.
On observe parmi les avantages majeurs le fait d’être moins dérangé par les collègues, la souplesse des horaires de travail, l’épanouissement personnel et professionnel, le fait d’effectuer moins de déplacements, et de perdre moins de temps pour ce faire, le fait de pouvoir mieux organiser son travail, ainsi qu’une meilleure organisation du temps entre vie professionnelle et vie privée. Ces données sont intéressantes puisque recueillies sur un nombre important de répondants (870), alors que les études portent généralement sur des nombres plus réduits.
Nous voulons surtout attirer l’attention ici sur le fait que la meilleure organisation du temps entre vie professionnelle et vie privée n’est pas nécessairement le plus important élément, mais parmi les plus importants tout de même, et qu’il est aussi parmi ceux qui suscitent le plus de satisfaction. La dimension conciliation emploi-famille a donc une certaine importance pour les individus qui pratiquent le travail mobile.
Tableau 9. Taux de satisfaction pour les divers apports du travail mobile
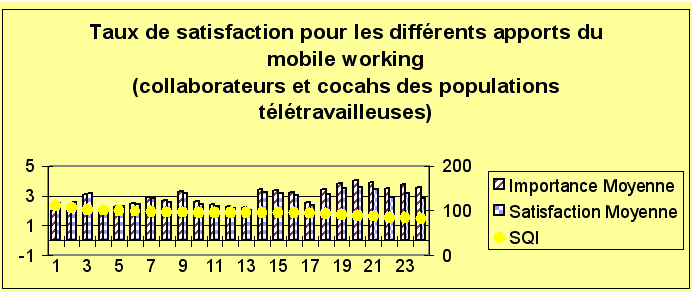
| 1 |
Opportunité d'intégrer à mes déplacements professionnels des arrêts pour motifs personnels |
7 |
Nouvelle qualité de vie |
13 |
Stimulation du travail d'équipe |
19 |
Meilleure organisation du temps de travail |
| 2 |
Nouveau mode de vie |
8 |
Diminution des frais professionnels |
14 |
Epanouissement personnel |
20 |
Efficacité professionnelle |
| 3 |
Moins dérangé par les collègues |
9 |
Souplesse des horaires de travail |
15 |
Epanouissement professionnel |
21 |
Moins de temps perdu en déplacements |
| 4 |
Rencontre de collègues jusque là inconnus |
10 |
Plus de temps libre pour faire ce qu'il me plaît |
16 |
Moins de déplacements professionnels |
22 |
Moins de stress |
| 5 |
Nouvelles aptitudes de communications avec les collègues |
11 |
Esprit de société renforcé |
17 |
Plus de temps pour mes amis |
23 |
Meilleure organisation du temps entre vie professionnelle et vie privée |
| 6 |
Sentiment de mieux accomplir mes divers rôles sociaux |
12 |
Plus à l'écoute des collègues en difficultés |
18 |
Meilleur étalement horaire des déplacements professionnels journaliers |
24 |
Plus de temps pour ma famille |
Le graphique précédent présente les moyennes des scores d’importance et de satisfaction attribués aux différents apports de mobile working ainsi que les indices SQI correspondants. Les moyennes se rapportent à l’échelle située du côté gauche du graphe (scores de 1 à 5). Par contre, les indices SQI se lisent en se référant à l’échelle située sur la droite. Il est intéressant de noter que l’indice de satisfaction n’est jamais inférieur à 80.
Les moyennes se rapportent à l’échelle de 1 à 5. Par contre, les indices SQI se lisent en se fonction de l’échelle située sur la droite. Il est intéressant de noter que l’indice de satisfaction n’est jamais inférieur à 80.
Nous avons aussi recueilli les données sur l’importance et l’insatisfaction attribués aux différents inconvénients découlant du travail mobile ainsi que les indices SQI correspondants.
On observe que la perte de l’esprit d’équipe, l’isolement social, la confusion entre vie professionnelle et vie familiale, le fait d’avoir plus de travail et plus de pression, ainsi que l’absence de visibilité vis-à-vis du manager constituent les principales sources d’insatisfaction. Ceci rejoint certains des résultats observés dans d’autres recherches (Tremblay, 2001, Cefrio, 2001), notamment en ce qui concerne l’isolement. Cependant, plusieurs éléments n’avaient pas fait l’objet d’observations chiffrées, en particulier la perte de l’esprit d’équipe, le fait d’avoir plus de travail et plus de pression et l’absence de visibilité vis-a-vis du manager. La confusion entre vie professionnelle et vie familiale a été évoquée par Felstead et Jewson (2000) comme pouvant être un problème important, en particulier pour les femmes, mais cela n’était pas ressorti comme un élément majeur d’autres enquêtes (Cefrio, 2001). Il est possible que l’évolution des technologies ou les rationalisations des dernières années explique en partie ce sentiment d’avoir plus de travail et plus de pression et le secteur des technologies de l’information est peut-être parmi ceux où le travail s’est intensifié.
Il faut noter aussi que la confusion vie personnelle et vie professionnelle n’est pas négligeable comme le montre le tableau 10.
Tableau 10. Taux d’insatisfaction pour les divers inconvénients du travail mobile
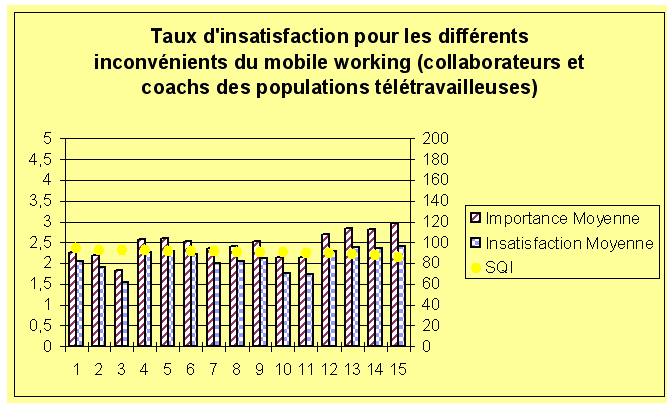
| 1 |
Aménagement coûteux du logement pour y aménager un bureau |
6 |
Plus de pression |
11 |
Plus de déplacements professionnels |
| 2 |
De nouveaux frais professionnels |
7 |
Perte de l'esprit d'entreprise |
12 |
Obstacle au travail d'équipe |
| 3 |
Avoir dû déménager pour disposer à domicile d’un bureau personnel |
8 |
Plus grande fatigue en fin de journée |
13 |
Isolement social |
| 4 |
Non visibilité vis à vis du manager |
9 |
Ne pouvoir compter que sur soi-même pour résoudre des problèmes professionnels |
14 |
Confusion vie professionnelle/vie familiale |
| 5 |
Plus de travail |
10 |
Conflits avec le manager |
15 |
Perte de l'esprit d'équipe |
Souhait de pratiquer le travail mobile
Nous nous sommes finalement intéressés à l’intérêt des répondants qui ne le pratiquent pas pour une éventuelle pratique du travail mobile Parmi les 404 individus appartenant aux groupes 2 et 3 (c’est à dire les individus n’ayant pas la possibilité technique de télétravailler), la très grande majorité, soit 94,8 % (ou 383 personnes) souhaiteraient pratiquer une forme au moins de mobile working. Seulement 21 individus ne le souhaitent pas.
Le tableau ci-dessous présente, pour les hommes ainsi que les femmes n’ayant pas la possibilité technique de télétravailler, les fréquences et pourcentages relatifs au souhait de pratiquer le mobile. Il est intéressant de noter que les pourcentages ne sont pas différents selon le sexe. En effet, la proportion d’individus souhaitant télétravailler est proche de 95% pour les deux sexes. Il faut donc en conclure que les femmes sont désavantagées, puisque comme nous l’avons vu plus haut, elles sont moins en position de faire du travail mobile, alors qu’apparemment, elles le souhaitent autant que les hommes.
Graphique Souhait de pratiquer le travail mobile, selon le sexe
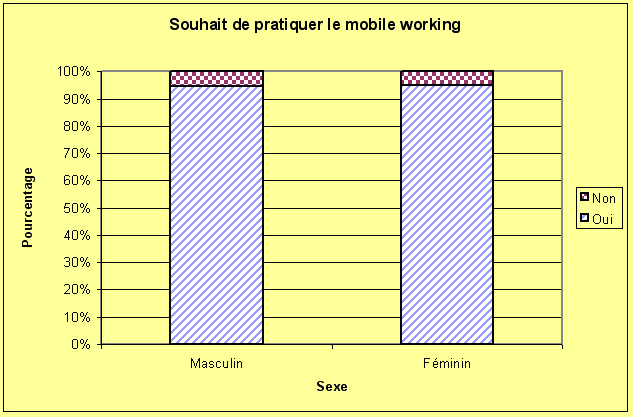
Conclusion
Nous avons voulu nous concentrer ici sur l’analyse de la pratique du travail mobile ou télétravail en tentant de déterminer si c’est le fait d’être une femme qui fait que l’on pratique cette forme de travail ou davantage le fait d’avoir des responsabilités familiales, soit la présence d’enfants plus précisément. Bien que les deux aspects soient souvent reliés, nous avons voulu tenter de les distinguer afin de déterminer si c’est le fait d’être une femme ou le fait d’avoir des enfants qui explique davantage l’intérêt pour le télétravail.
Ce faisant, nous avons constaté dans notre analyse que les femmes ont moins de possibilités que les hommes de pratiquer le télétravail ou travail mobile, entre autres parce qu’elles ne sont apparemment pas dans les fonctions où cela est généralement prévu. D’autres questions portaient sur les avantages du télétravail et travail mobile et permettent de voir si la conciliation emploi-famille peut être jugée une variable importante, sans être la plus importante. On observe parmi les avantages majeurs le fait d’être moins dérangé par les collègues, la souplesse des horaires de travail, l’épanouissement personnel et professionnel, le fait d’effectuer moins de déplacements, et de perdre moins de temps pour ce faire, le fait de pouvoir mieux organiser son travail, ainsi qu’une meilleure organisation du temps entre vie professionnelle et vie privée. Ces données sont intéressantes puisque recueillies sur un nombre important de répondants (870), alors que la plupart des études portent généralement sur des nombres plus réduits, comme c’était le cas avec une étude antérieure (Cefrio, 2001).
Nous voulons surtout attirer l’attention ici sur le fait que la meilleure organisation du temps entre vie professionnelle et vie privée n’est pas nécessairement le plus important élément, mais parmi les plus importants tout de même, et qu’il est aussi parmi ceux qui suscitent le plus de satisfaction. La dimension conciliation emploi-famille a donc une certaine importance pour les individus qui pratiquent le travail mobile.
Un des résultats les plus intéressants, sinon le plus intéressant de nos analyses, c’est de constater que le fait de pratiquer effectivement une forme au moins de travail mobile est significativement lié au fait d’avoir des enfants (p=0.0039). Le tableau 6 a permis de montrer que les personnes avec enfants pratiquent le travail mobile beaucoup plus que les autres, plus du double du pourcentage des personnes sans enfant. C’est certes là un résultat très intéressant, qui montre que la présence d’enfants peut accroître l’intérêt pour le télétravail et travail mobile, de sorte que l’on peut conclure qu’au-delà de l’intérêt présumé des femmes pour cette forme de travail, c’est peut-être davantage la présence d’enfants qui rend cette pratique intéressante pour les salariés, et ce pour les hommes comme les femmes.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le télétravail est souvent présenté comme un avantage du point de vue de la conciliation des activités professionnelles et familiales (dont responsabilités liées aux enfants), mais on le présente souvent comme un avantage concernant surtout les femmes. Or, bien que ce soit généralement les femmes qui soient responsables de ces activités familiales et parentales, il est intéressant de voir les choses plus largement et de considérer que les hommes avec enfants peuvent aussi être intéressés par cette pratique du travail mobile. Nos données permettent de confirmer que ce n’est pas tant le sexe (le fait d’être une femme) qui explique le recours au télétravail, mais le fait d’avoir des enfants.
Bien sûr, certaines limites s’appliquent à cette recherche. Ainsi, bien qu’elle ait été réalisée auprès d’un nombre important de répondants, permettant de faire des analyses statistiques intéressantes, elle ne porte que sur une seule organisation. Par ailleurs, cette organisation est du domaine des technologies de l’information, ce qui favorise peut-être le télétravail et travail mobile des hommes, dont ceux avec enfants, puisque ce secteur est généralement plus ouvert que d’autres à l’égard du télétravail. Quoi qu’il en soit, nous considérons que le fait de montrer que c’est la présence d’enfants qui joue davantage que le fait d’être une femme, constitue un résultat intéressant, à approfondir dans des recherches sur le télétravail et travail nomade, et la pratique de cette forme d’emploi par hommes et femmes, avec ou sans enfants.
References bibliographiques
Bangemann, Martin (1994).Europe and the Global Information Society. Recommendation to the European Council. Brussels, EEC.
Benchimol, Guy (1994). L’entreprise délocalisée. Paris, Éditions Hermès.
CEFRIO (2001). Le télétravail. Montreal: IQ éditeur.
Chapman, A.J., et al. (1995). “The Organizational Implications of Teleworking.” International Review of Industrial and Organizational Psychology, 10: 229-248.
Christensen, K.E. (1987). “Impacts of Computer-Mediated Home Based Work on Women and Their Families.” Office, Technology and People, 3: 211-230.
Felstead, A., and N. Jewson (2000). In Home, at Work. Towards an Understanding of Homeworking. London, Routledge. 196 p.
Hafer, M. (1992). Telecommuting: An Alternate Route to Work, Step by Step Guide. Washington: Washington State Energy Office.
Huws, U., B.K. Werner and S. Robinson (1990). Telework: Towards the Elusive Office. London: John Wiley & Sons, collection “Information Systems Series.” 266 p.
Institute for Employment Studies (2001). eWork in Europe; the Emergence 18 Country Employer Survey. Brighton. 84 p.
Kurkland, Nancy B., and Diane. E. Bailey (1999). “Telework: The Advantage and Challenge of Working Here, There, Anywhere, and Anytime.” Organizational Dynamics, Fall, pp. 53-68.
Olson, M.H. (1989). “Work at home for computer professionals: Current attitudes and futures prospects.” ACM Transactions on Office Informations Systems, 7: 317-338.
Pichault, F. and S. Grosjean (1998). Du télétravail au travail à distance. Namur: Fonds national de la recherche collective. 146 p.
Pratt, J. (1984). “Home Teleworking: A study of its pioneers.” Technological Forecasting and Social Change, 25: 1-14.
Taskin, L., & Vendramin, P. (2004). Le télétravail, une vague silencieuse. Les enjeux d’une nouvelle flexibilité. PUL, Louvain-la-Neuve, Belgium.
Thomsin, Laurence et Diane-Gabrielle Tremblay (2006) Le « mobile working » :De nouvelles perspectives sur les lieux et les formes du télétravail. Interventions économiques. No 34. www.teluq.uqam.ca/interventionseconomiques
Tremblay, D.-G. (2001). Télétravail: concilier performance et qualité de vie. Rapport de recherche Cefrio. 84 p.
Tremblay, D.-G. (2002). “Balancing Work and Family with Telework? Organizational Issues and Challenges for Women and Managers.” Women in Management. Manchester: MCB Press. Volume 17, Issue 3/4, pp. 157-170.
Tremblay, Diane-Gabrielle (2003). “Telework: A New Mode of Gendered Segmentation? Results from a study in Canada.” Canadian Journal of Communication. Vol. 28, No. 4, pp. 461-478.
Tremblay, D.-G. (2003a). Le télétravail; ses impacts sur l’organisation du travail des femmes et la conciliation emploi-famille. Research note by the Canada Research Chair on the Socio-Organizational Challenges of the Knowledge Economy. No. 2003-10. Available at: http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/
Tremblay, D.-G. (2004). Conciliation emploi-famille et temps sociaux. Toulouse. Éditions Octares and Presses de l’université du Québec.
Tremblay, D.-G. (2006). Le télétravail. Encyclopédie Vuibert de l’informatique. Paris: Vuibert.
Tremblay, D.-G., Renaud Paquet and Elmustapha Najem (2006a). “Telework: a way to balance work and family or an increase in work-family conflict?” Canadian Journal of Communication. Vol. 31, No. 2. October 2006.
Tremblay, D.-G., Elmustapha Najem and Renaud Paquet (2006b). “Articulation emploi-famille et temps de travail: De quelles mesures disposent les travailleurs canadiens et à quoi aspirent-ils?” Enfance, Famille et Génération, No 4. http://www.erudit.org/revue/efg/
Tremblay, Diane-Gabrielle , Catherine Chevrier and Martine Di Loreto (2007). “Le travail autonome: une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle…ou une plus grande interpénétration des temps sociaux ?” Loisir et société/Leisure and Society, vol. 29 no 1. pp.191-214. .
Tremblay, Diane-Gabrielle, Catherine Chevrier and Martine Di Loreto (2006). “Le télétravail à domicile:
Meilleure conciliation emploi-famille ou source d’envahissement de la vie privée ?” Interventions économiques, No. 34. www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir
Vandercammen, Marc (1994). Télétravail. Brussels, Institut wallon d’études de recherches et de formation.
Notice biographique :
Laurence Thomsin est chercheure à l’université de Liège, en Belgique ; Diane-Gabrielle Tremblay est professeure à la Téluq de l’université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir (www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir). Toutes deux ont publié de nombreux articles et fait de nombreuses recherches sur le télétravail et le travail nomade. Elles s’intéressent aussi à la problématique du vieillissement de la population et de la main-d’œuvre et à ses effets sur les fins de carrière des hommes et des femmes. Elles ont également été invitées à présenter des communications dans divers réseaux, dont le réseau Gender, work and family, de la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), que coordonne D.-G. Tremblay.
[1] Certains éléments, dont la présentation des répondants, ont été exposés dans un autre article, qui ne mettait toutefois pas l’accent sur la dimension genre et présence d’enfants. On le retrouve sur le site de la revue Interventions économiques. ( cité en bibliographie : Thomsin et Tremblay- 2006).

labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2008-janeiro/junho 2008