
labrys,
études féministes/ estudos feministas
juillet / décembre 2013 -julho / dezembro 2013
Devant la tendance néoréglementariste dominante dans la recherche sur la prostitution :
perspectives critiques
Shanie Roy [1]
Résumé:
S’inscrivant dans un continuum d’appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes, l’exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles est commercialisée, industrialisée, néolibéralisée et mondialisée. L’article propose une étude critique du projet de recherche « Repenser le travail du sexe » dont la chercheure principale est Chris Bruckert du département de criminologie à l’Université d’Ottawa. Le système prostitutionnel y est présenté comme une industrie dans laquelle une meilleure gérance est possible, aidée par la décriminalisation de ses activités, et où « les travailleuses du sexe » peuvent contrôler et améliorer leurs « conditions de travail ». L’auteure de l’article montre comment une telle analyse évacue les rapports d’appropriation et d’exploitation sexuée et sexuelle indissociables et constitutives de la prostitution. À partir de l’épistémologie des survivantes, Shanie Roy souligne aussi que le point de vue des survivantes dénonçant le système prostitutionnel n’est considéré dans aucun volet de la recherche de Bruckert.
Mots-clés : prostitution; exploitation sexuelle; travail du sexe; abolitionnisme; féminisme abolitionniste; néoabolitionnisme; règlementarisme; néorèglementarisme; survivantes de la prostitution; femmes-prostituées
« Du sexe avec toutes les femmes aussi longtemps que tu veux, aussi souvent que tu veux et comme tu veux. Sexe, Sexe anal. Sexe oral. Nature. Sexe de groupe à 3. Gangbang » pour 70 euros le jour ou 100 le soir (Angrywomenymous, 2013). C’est ce que le Pussy Club en Allemagne, pays autorisant et règlementant la prostitution depuis 2002, diffusait comme promotion dès de son ouverture en 2011 (Fondation Scelles, 2009). Des centaines d’hommes ont alors répondu à l’appel de leurs besoins sexuels : « le weekend de l'ouverture ce sont 1700 clients qui répondirent à l'offre. Des bus vinrent de loin. Les journaux locaux écrivirent qu'il y avait une queue de près de 700 hommes devant le bordel » (Angrywomenymous, 2013). Sur les forums de discussion de clients-prostitueurs, ces derniers soulignaient qu’après quelques heures, les femmes-prostituées ne fournissaient plus à la « demande » (Angrywomenymous, 2013).
L’Histoire tend à présenter l’appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes à titre de prostituées[2] comme un fait social paradoxalement ahistorique et un pilier de l’organisation sociale sous la logique d’une naturalisation des rapports sociaux. L’évocation familière du « plus vieux métier du monde » ou celle, plus libérale, du « droit à la profession de prostituée », illustre cette tendance à la non prise en compte des rapports de pouvoir historiques qui traversent et encadrent le système prostitutionnel. Le discours social justifiant la prostitution dévoile un entérinement des rapports et des structures d’exploitation formant et gouvernant la classe des femmes (Navarro Swain, 2011; Guillaumin, 1978).
« Abolir la prostitution » : cette affirmation programmatique recèle en fait une idée simple : le refus de l’aliénabilité du corps et de la sexualité (ATTAC, 2008). C’est avec ce postulat de base que le texte qui suit vise à recadrer les discours justificatifs de la prostitution dans leur historicité et à décortiquer leur argumentaire pour y déployer une perspective critique féministe abolitionniste[3] révolutionnaire. Bien qu’il serait pertinent d’examiner le discours persistant des (néo)conservateurs ou des prohibitionnistes, le discours dominant sur la prostitution dans les diverses instances et institutions semble actuellement de tendance néoréglementariste. Par ailleurs, un tel discours a pris de l’ampleur au sein du mouvement féministe à travers certains courants de pensées.
(Néo)libéralisme et (néo)réglementarisme
En tant qu’idéologie dominante du système capitaliste, le libéralisme est véhiculé à travers une grande diversité d’instances, et ce, sous une pluralité de formes et de contenus (Ricci et al,, 1975). Concourant au développement et à la fixation des systèmes de sexe, de race et de classe (Falquet et al., 2010), cette idéologie sert d’ancrage au discours faisant miroiter la libéralisation et la professionnalisation de la prostitution. En présentant les femmes-prostituées comme des « travailleuses du sexe » devant obtenir la liberté de se prostituer, le néoréglementarisme légitime en fait un système d’exploitation soi-disant vieux comme le monde visant à maintenir l’accessibilité et la disponibilité du corps et de la sexualité d’un groupe social principalement composé de femmes et de filles. Comme le souligne Claudine Legardinier, « la prostitution "libre" relève non pas des libertés, mais du libéralisme » (ATTAC, 2008). Cette position sur la prostitution est principalement véhiculée par des organisations mondiales gouvernementales et non gouvernementales, un lobby de proxénètes, les médias, des réseaux d’universitaires, des partis politiques et des syndicats, des organismes et des groupes progressistes ou féministes, ainsi que des associations de « travailleuses du sexe » (Jeffreys, 2009).
Aux fondements idéologiques du courant néoréglementariste ou pour la décriminalisation totale de la prostitution, on retrouve le réglementarisme et le prohibitionnisme, qui présentent tous deux, bien que différemment, la prostitution comme « un mal nécessaire ». Autrement dit, on ne peut que l’organiser ou la contrôler (Geadah, 2003). Voilant des visées initiales d’aménagement des méfaits sociaux liées aux activités prostitutionnelles, le courant pour la décriminalisation totale de la prostitution propose que celle-ci soit déstigmatisée, reconnue et organisée « comme tout autre travail ». En concevant comme des « travailleuses du sexe » les femmes exploitées sexuellement par les clients-prostitueurs et les proxénètes, le courant néoréglementariste banalise et normalise les rapports d’exploitation sexuée et sexuelle dans le système prostitutionnel. De ce fait, il présente d’une manière pacifiée les rapports prostitutionnels s’insérant dans l’appropriation des femmes par les hommes. Ce courant a d’ailleurs pris d’assaut le mouvement féministe dans les années 1970 sous l’influence du mouvement gay et lesbien, le backlash du féminisme dit « pro-sexe » et l’émergence des théories queer et féministes postmodernes (Jeffreys, 2009 ; Audet, 2005).
Notes pour une épistémologie des survivantes
De 16 ans à 18 ans, j’ai été dans l’industrie du sexe : « serveuse sexy », « escorte outcall en agence » et « escorte indépendante ». Mobilisée par ma colère envers les hommes et mon état permanent de coquille dépossédée[4], j’ai commencé à m’impliquer dans le mouvement pour l’abolition du système prostitutionnel. C’est-à-dire que j’ai voulu contribuer à la lutte féministe pour l’élimination des structures et pratiques constituant un système d’exploitation sexuelle organisé mondialement presque exclusivement par et pour la classe des hommes, tirant principalement avantage de la classe des femmes.
C’est en premier lieu par le biais de leurs témoignages que les survivantes s’engagent dans les luttes idéologiques concernant la prostitution. Les survivantes sont des femmes ayant été exploitées sexuellement qui dénoncent le système prostitutionnel et osent exiger son abolition, de manière autonome ou réunies en associations[5]. « Survivantes », non pas pour revendiquer la reconnaissance d’une identité de femmes post-prostituées ou celle d’avoir survécu à la prostitution grâce un quelconque héroïsme - bien que « sortir de la prostitution » représente un processus chargé d’épreuve. Le terme « survivantes » tire son sens dans le fait qu’elles doivent survivre avec la charge d’un vécu d’exploitation dans le système prostitutionnel.
La prostitution s’inscrit dans notre chair par un processus de marquage nous dépossédant de nous-mêmes, sans rachat possible. Comme nous avons été aliénées prostitutionnellement, nos récits et écrits tracent le point de vue des survivantes sur les rapports sociaux et les structures sociales. De plus, nos pratiques de solidarisation, de résistance et d’action représentent entres autres un nouveau prisme de perspectives féministes et d’analyse sous l’angle de la sociologie des mouvements sociaux.
Dans la conjoncture actuelle, marquée par des efforts d’individualisation et de normalisation de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, confronter la rhétorique pro- travail/industrie du sexe en tant que survivante entrave l’ordre prostitutionnel. Nos témoignages et nos revendications ne cadrant pas avec l’image des « travailleuses du sexe », les tenants et tenantes de la posture néoréglementariste les disqualifient systématiquement en les considérant comme non-représentatifs de la réalité prostitutionnelle. Exigeant un important travail émotionnel, les témoignages des survivantes sont stratégiquement récupérés par le néoréglementarisme pour catégoriser la prostitution sur un mode binaire opposant la prostitution dite « libre », nommée « travail du sexe » et celle dite « forcée », nommée « traite, exploitation sexuelle ou esclavage » (Audet, 2005 : 24) Ainsi, notre point de vue et notre militance en tant que survivantes se trouvent niés par le discours néoréglementariste qui accuse en outre les féministes abolitionnistes de victimiser les « travailleuses du sexe » et même d’être violentes envers elles (Stella, 2011).
Utilisant une novlangue facilement présentable aux médias et aux institutions étatiques, les acteurs et actrices universitaires de ce courant obligent les survivantes et les féministes abolitionnistes à constamment redéfinir, recontextualiser et justifier leurs analyses et leurs pratiques ce qui essouffle la production de savoirs et l’engagement néoabolitionnistes. Ainsi, dans cet objectif de développer des stratégies combattives, il est pertinent de connaître les récentes analyses développées par les acteurs et actrices universitaires du mouvement pro-travail/industrie du sexe. C’est aussi pour répondre à l’accusation de considérer les femmes étant ou ayant été prostituées comme des « victimes sans voix[6] » que le projet de recherche « Repenser le travail du sexe » sera présenté, critiqué et analysé.
La dérive néoréglementariste dans la recherche sur la prostitution : l’ère de « la gérance du travail du sexe »
Dans un cadre prohibitionniste, la prostitution juvénile est perçue comme un fléau social et la prostitution adulte est considérée légalement et moralement comme une nuisance publique. Le fait que les activités de prostitution se soient déplacées dans « la rue » suite à la répression des lieux prostitutionnels « hors-rue » à Toronto et à Vancouver, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, renforce leur problématisation en termes de nuisance publique. Cette situation donne le coup d’envoi aux financements de la recherche sur la prostitution (Lowman, 2001).
Parallèlement à l’intérêt médiatique pour ce tout nouveau problème, c’est-à-dire l’explosion de la prostitution « de rue » dans plusieurs grandes villes canadiennes, la production de recherche sur la prostitution, qui était relativement stable avant la fin des années 1980, s’accroit considérablement. Conséquemment, « les prostitués de la rue ont probablement participé à plus de sondages-recherches que toute autre [catégorie sociale] au Canada » (Lowman, 2001). Auparavant, les recherches sur la prostitution portaient presque uniquement sur l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes et sur la façon de rétablir l’ordre dans l’espace public troublé par la prostitution. Outre les efforts de néolibéralisation, la visibilité de la prostitution et les préoccupations amenées par le VIH/SIDA apparaissent comme les principales motivations du financement à la recherche sur la prostitution des institutions gouvernementales (Lowman, 2001; Sous-comite de l'examen des lois sur le racolage, 2006).
Le travail de fouille biographique et bibliographique réalisé pour cet article suggère que depuis une quinzaine d’année, il y a une nouvelle vague de production de recherches portant sur la prostitution. Plus précisément, les recherches se penchent maintenant sur la prostitution « hors-rue », le proxénétisme et les clients-prostitueurs, les enjeux législatifs et juridiques, de même que sur les ressources, outils et méthodes d’interventions auprès des personnes dans l’industrie du sexe ou « par et pour les travailleuses du sexe ». Plus récemment, la plupart des recherches produites par des universitaires et des organismes retiennent des positions explicitement néoréglementaristes. C’est pourquoi il est possible d’avancer qu’un groupe d’acteurs et d’actrices universitaires pro-travail/industrie du sexe - s’opposant aux féministes abolitionnistes, intervenantes, survivantes et chercheuses dénonçant les violences inhérentes à la prostitution - accapare actuellement la production de recherches sur la prostitution au Canada (Audet, 2005).
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de recherche « Repenser le travail de gérance dans l’industrie du sexe » mené au sein de divers institutions universitaires par Chris Bruckert, Jenn Clamen, Maria Nengeh Mensah, Patrice Corriveau, Leslie Jeffrey et Colette Parent, en collaboration avec les organismes Maggie’s (Toronto), Prostitutes of Ottawa/Gatineau Work, Educate and Resist, Stella (Montréal) et Stepping Stone (Halifax)[7]. Encadrée par l’Université d’Ottawa en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Nouveau-Brunswick, ce projet comporte deux publications : un rapport de recherche intitulé « Beyond Pimps, Procurers and Parasites : Mapping Third Parties in the Incall/Outcall Sex Industry » (uniquement disponible en anglais[8]) et un livret, destiné spécifiquement aux « tierces personnes » et aux « travailleuses du sexe » (accessible via internet, Bruckert et al., 2013).
Cette étude s’appuie sur des entrevues conduites auprès de 50 « tierces personnes » et de 27 femmes-prostituées provenant du sud et de l’est de l’Ontario, du Québec et des Maritimes. Elle a comme objectif de comprendre et d’explorer « les expériences et les perceptions des gérants », « les relations de travail entre les gérants et ceux et celles qui travaillent pour et avec eux » et « comment les lois et les politiques publiques influencent le travail de gérance dans l’industrie du sexe et impactent sur les relations de travail » (Université d’Ottawa, 2013).
Bénéficiant du soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le livret « Gérer le travail du sexe : information pour les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall et outcall » (Bruckert, et al, 2013) présente le rapport de recherche sous une forme vulgarisée et attractive. S’inscrivant dans la dérive néoréglementariste dans la production canadienne de recherche sur la prostitution, il a pour but d’« aider les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall et outcall à faire des choix et à prendre des décisions de travail éclairées dans ce contexte légal. » (p. 6). En plus d’évacuer de son analyse les rapports de pouvoir inhérents à la prostitution qui forment et orientent l’industrie du sexe, ce livret se trouve, non seulement, à faire la promotion de l’exploitation sexuelle commercialisée des femmes et des filles, mais à donner un outil visant à la faciliter.
Présentation du livret sur « la gérance du travail du sexe »
En introduction, les auteur.e.s. de « Gérer le travail du sexe : information pour les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall et outcall », avancent que les « tierces personnes » sont affectées par de « nombreux préjugés et stéréotypes ». On les dépeindrait comme des hommes violents ou appartenant à des groupes racisés, une vision jugée simpliste des relations entre les proxénètes et les femmes-prostituées habiterait l’imaginaire collectif. La documentation des réalités des « individus dans la prostitution » montre la complexité de ces « relations ». En effet, selon ce projet de recherche, la variété de structures organisationnelles du « travail du sexe », de même que la série d’aptitudes et de compétences en matière de gérance, sont semblables à celles des autres modes d’organisation du travail. Il est ensuite énoncé que « pour la plupart des travailleuses du sexe, qu’elles soient indépendantes ou en agence, une tierce personne contribue, même minimalement, à l’accomplissement de leur travail » (p. 6). Se basant sur une analyse des « relations de travail » dans l’industrie du sexe, cette recherche avance que la criminalisation mine la capacité à « mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer un environnement de travail sécuritaire » (p. 6) et de « bonnes relations et conditions de travail ».
Les « structures organisationnelles du travail du sexe »
Présentant le rôle des gérants et propriétaires d’entreprises prostitutionnelles, et des diverses personnes participant au déroulement ou au développement des activités prostitutionnelles, la section « Qui sont les tierces personnes ? » révèle qu’il y a une échelle de contraintes environnementales et structurelles affectant les « travailleuses du sexe » :
Le contrôle et l’autorité que détient une travailleuse du sexe sur ses conditions de travail ne dépend pas du fait qu’elle travaille ou non à son compte. C’est plutôt l’environnement et la structure organisationnelle de travail qui dictent le contrôle et l’influence dont elle peut bénéficier. (p. 9).
Exposant les hiérarchisations des rôles et responsabilités des « tierces personnes » des secteurs incall et outcall, les auteur.e.s schématisent trois structures prostitutionnelles ayant « de plus, à moins, à aucun » contrôle sur l’organisation du « travail du sexe » : les agences, les associés et les contractants (p. 10). Première forme de gestion prostitutionnelle, l’agence serait une entreprise qui fixe les méthodes et les conduites prostitutionnelles et qui engage des femmes-prostituées « dans le cadre d’une relation de type employeur-employée [où] la surveillance est assurée minimalement par un individu » (p.11). Pour leur entreprise d’organisation des « transactions », les agences impliquent des « tierces personnes », tel un gérant, un chauffeur ou une réceptionniste, qu’elles soient de petite, moyenne ou grande taille. Le second mode d’organisation serait composé d’agents, de mentors, d’organisateurs d’évènements et de fournisseurs de lieux prostitutionnels qui organisent ou facilitent les transactions entre les « travailleuses du sexe » et les clients.
Ces « tierces personnes » sont présentées comme étant des associées qui « travaillent avec les travailleuses du sexe ». Le troisième type d’organisation de la prostitution est constitué de contractant.e.s (assistant personnel, chauffeur, agent de sécurité, webmestre, etc.) engagé.e.s « par ou pour » les femmes-prostituées. Ces « tierces personnes » sont décrites comme fournissant « un service » à une « travailleuse du sexe » ou à une entreprise.
Décriminalisation de la prostitution : « évolution des lois » ou fin des entraves légales à l’industrie du sexe
La section « Contexte légal » présente une analyse de l’impact des lois et règlements qui entourent la prostitution. Elle débute en soulignant qu’au « Canada, le fait d’échanger un service sexuelle contre rémunération n’est pas et n’a jamais été illégale » (p. 15). Détaillant les possibles accusations criminelles affectant les activités prostitutionnelles, leur criminalisation est présentée comme un obstacle à la pratique sécuritaire du « travail du sexe » d’autant plus que le Code criminel canadien considère « le travail des tierces personnes » comme un crime. Les propos d’une propriétaire d’agence d’escortes outcall à Montréal exposent ces entraves légales :
La loi a un impact sur la façon de présenter les services. Étant donné qu’il est illégal de vendre des services sexuels, il faut prendre des détours pour expliquer au client ce à quoi il peut s’attendre. Par exemple, dans le jargon de l’industrie, le « service GFE » ou « girlfriend experience » est un terme employé pour une pratique particulière. Les clients ont une idée de ce que c’est. Mais en réalité, ça ne veut rien dire de spécifique. GFE, ce n’est pas dans le dictionnaire! (p. 15)
Au niveau municipal, les permis d’exploitation d’entreprise et les règlements de zonage ont des répercussions sur « le travail des tierces personnes » et des « escortes indépendantes qui se déplacent d’une ville à une autre » (p. 24). En jouant avec le langage, les municipalités réussiraient, en partie, à réglementer l’industrie du sexe : « Par exemple, plutôt que d’inscrire dans un règlement la mention explicite "salon de massage érotique", on inscrit simplement "salon de massage" » (p. 24), faisant en sorte que les services permis doivent correspondre à la définition de « salon de massage ». De plus, le fait que « la clientèle ne comprend pas toujours que le prix demandé ne couvre que les activités permises par la loi » (p. 25) entraine des inconvénients sur le plan de « la gérance du travail du sexe ». Pour ce qui est des règlements de zonage entravant l’industrie du sexe, il est avancé qu’il y a un manque de zone où les salons de massage sont permis et que les zones le permettant se trouvent souvent dans des quartiers industriels et isolés.
Les « tierces personnes »
Explicitement destinée aux gérants et propriétaires des établissements incall et outcall et à leurs auxiliaires, mais pouvant aussi s’adresser aux femmes qualifiées d’escortes indépendantes, la section « Information pour les tierces personnes » présente les enjeux et responsabilités dans la « gérance du travail du sexe ». Les fonctions de réceptionniste, chauffeur, webmestre, photographe, agent et fournisseur d’espaces de travail font l’objet d’une description de tâches, alors que sont énumérées les « qualités des tierces personnes recherchées par les travailleuses du sexe ». Ces dernières comprendraient notamment le respect de la confidentialité des activités de prostitution et de « la hiérarchie de l’autorité et des responsabilités entre les propriétaires, les gérants, les réceptionnistes, les chauffeurs, etc. » (p. 35-36). On souligne d’ailleurs qu’un code de conduite et des règles d’établissement devrait être mis en place, pour maintenir la « discrétion » des activités prostitutionnelles.
Les responsabilités des « tierces personnes » du secteur incall regroupées sous le volet « maintenance et entretien incluraient le développement d’une image ou d’une ambiance, le nettoyage des lieux, la fourniture du matériel lié aux activités de prostitution et le recrutement. Encadrée par des lois et règlements qui « posent des défis pour la publicité » (p. 31), la promotion du « travail du sexe » repose sur l’achat d’espaces publicitaires sélectionnés en fonction de la clientèle visée (journaux, sites internet d’annonces gratuites et payantes, brochures de voyage et sites web de rencontres), ainsi que sur la participation aux forums de discussions des clients-prostitueurs.
Les « travailleuses du sexe »
La section « Information pour les travailleuses du sexe » s’intéresse à l’« environnement de travail » et aux « avantages et inconvénients de travailler avec une tierce personne ». Il y est mentionné que « lorsque vient le temps de décider où travailler, avec qui ou pour qui, les travailleuses du sexe [doivent prendre en considération] leur sentiment par rapport au fait d’avoir à respecter un code de conduite et des règlements établis par quelqu’un d’autre. » (p. 37-38). Dans la même logique, le type de « clientèle et de services sexuels offerts », les quotas ou le roulement des agences, de même que la gestion de l’argent et des prix, sont autant d’éléments qui dirigeraient les femmes-prostituées vers une agence soit incall soit outcall.
Maximiser la sécurité et la santé dans l’industrie du sexe…
La partie intitulé « Sécurité et Santé au travail » donne des informations sur les stratégies et pratiques visant à « protéger les travailleuses et l’entreprise » (p. 47) telles le filtrage des clients, l’utilisation de caméras de surveillance, la tentative de dissuasion de la violence des clients-prostitueurs en rendant visible le personnel de sécurité ou les « appels de sécurité entre les tierces personnes et les travailleuses du sexe ». Par ailleurs, afin de faire face aux défis importants que pose la criminalisation de la prostitution sur le plan de la santé émotionnelle des femmes-prostituées, il semble que « souvent, [les tierces personnes] débriefent et ventilent avec [elles] après les rendez-vous, particulièrement lors de mauvaises expériences ou quand il y avait absence d’affinité ou de compatibilité avec le client » (p. 51).
Pour ce qui est de la section « santé physique et sexuelle », le « sécurisexe » et des moyens comme utiliser une terminologie claire pour décrire les actes prostitutionnels sont présentés comme étant utilisés par les femmes-prostituées afin de maximiser leur santé sexuelle. Comme le souligne Beatrice, propriétaire d’une d’agence d’escortes à Hamilton, « les travailleuses du sexe s’assurent que [le préservatif] est en place et qu’il est bien installé. Elles savent aussi comment déterminer s’il y a quelque chose qui cloche. Si c’est le cas, elles arrêtent. » (p. 51).
« L’entreprenariat éthique dans la gérance du travail du sexe »
La « réflexion sur l’entreprenariat éthique » soutient que la criminalisation empêche de mettre en place les mesures assurant « un environnement de travail sécuritaire » et « rend ardu le pouvoir négocier de meilleures conditions de travail. » (p. 55). D’après les auteur.e.s, l’entreprenariat éthique recherche un équilibre entre « les tierces personnes » et les femmes-prostituées qui viseraient conjointement à mettre en place de « bonnes conditions et pratiques de travail » dans un contexte légal donné. À cet égard, la réflexion se termine sur les points de tensions entre les « tierces personnes » et les « travailleuses du sexe » qui seraient surtout provoquées par la criminalisation de la prostitution. On détaille ainsi les répercussions sur les « travailleuses du sexe » et sur l’entreprise. Les principales problématiques énoncées sont l’ambigüité inhérente à l’offre de service, les contraintes face au recours à la police et les pratiques de recrutement strictes ou discriminatoires quant à la consommation de drogues et au statut de citoyenneté des femmes-prostituées, de même que la limitation du « pouvoir de négociation » de celles-ci avec les clients-prostitueurs.
« Repenser la gérance du travail du sexe » : décontextualisation et dématérialisation des rapports d’appropriation et d’exploitation prostitutionnels
Pour mieux cerner les nombreux éléments précédemment présentés, la section qui suit vise à identifier, décortiquer et positionner les rapports de force effectifs traversant le système prostitutionnel et l’un de ces bras politique, le néoréglementarisme.
La voix des (néo)proxénètes et l’occultation des rapports de pouvoir
En premier lieu, l’expression « tierce personne » (third parties en anglais) dissimule la violence du système prostitutionnel organisé par les (néo)proxénètes qui tirent profit de l’exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales. Ce faisant, elle euphémise et neutralise les rapports prostitutionnels.
Bien que les auteur.e.s. critiquent la criminalisation des femmes-prostituées, le libéralisme intrinsèque à leur perspective les conduit à défendre les intérêts des (néo)proxénètes. En effet, associer les « droits des travailleuses du sexe » à ceux des proxénètes, collaborateurs et clients-prostitueurs relève d’une occultation de leurs rapports antagoniques (Audet, 2005 ; ATTAC, 2008). Lorsque l’on considère les intérêts des femmes-prostituées comme étant dépendants de ceux des (néo)proxénètes et des clients-prostitueurs, il est possible d’appuyer la décriminalisation totale de la prostitution et l’entreprenariat « du travail du sexe ».
Sans négliger la violence symbolique et matérielle que cela représente, mettre l’accent sur les possibles accusations envers les (néo)proxénètes et les personnes non-prostituées occulte le fait que 92% des personnes accusées en vertu de cette dernière infraction sont des femmes-prostituées, majoritairement dans la prostitution de rue et que 90% des infractions rapportées ont trait à la communication à des fins de prostitution (Sous-comite de l'examen des lois sur le racolage, 2006). Il n’est pas non plus fait mention de la dynamique du relâchement de l’interprétation des lois quant aux activités de l’industrie du sexe (Ricci, Kurtzman et Roy, 2012) faisant en sorte que
«[ …]de 1974 jusqu’au milieu des années 90, le nombre d’accusations portées pour non-respect des dispositions législatives sur les maisons de débauche est passé d’environ 1 000 à 200 par année [et qu’aujourd’hui], les administrations municipales autorisent le commerce de la prostitution hors rue [en fermant les yeux sur les activités prostitutionnelles] » (Lowman, 2001 : 6).
Dans cette publication, les préjugés et les stéréotypes,
puis la criminalisation et la stigmatisation sociale entourant « le travail
du sexe » et sa « gérance » sont considérés comme étant les principales
problématiques affectant l’industrie du sexe. La prostitution est dépeinte
comme relevant d’un choix ou d’une décision éclairée des femmes concernant
le mode et les pratiques de l’entreprise prostitutionnelle ou leur cadre
légal. Cependant, ces « choix » apparaissent plutôt liés aux expériences
d’abus et de violences sexuelles, de même qu’aux contraintes découlant
des rapports sociaux de classe et de « race », du statut de citoyenneté,
du niveau de consommation de drogues ou encore des exigences physico-sexuels
exigés par les prostitueurs et les (néo)proxénètes (Poulin,
2005 ; Audet, 2005 ; Ricci, Kurtzman et Roy, 2012 ; Lamont, 2010). Par
ailleurs, « la reconnaissance de la prostitution comme un travail » qui
vise prétendument à contrer la « prostitution forcée » fait en sorte qu’en
Allemagne, les femmes travaillant dans les bars ou la restauration qui
perçoivent des prestations de chômage doivent accepter les « propositions
d’emploi » des établissements prostitutionnels, sous peine de perdre leurs
droits (Poulin, 2005).
Pourtant, en révélant le point de vue des (néo)proxénètes, le projet de recherche « Repenser le travail du sexe » livre des informations utiles au développement d’une perspective féministe abolitionniste. Le livret « Gérer le travail du sexe : information pour les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall et outcall » expose par exemple l’actuelle hiérarchisation et technologisation des pratiques prostitutionnelles transformant l’implication des (néo)proxénètes dans l’industrie du sexe (Bouffartigue, Linhart, Moutet, 2005). En fait, la division des rôles et fonctions des (néo)proxénètes dans les structures d’exploitation prostitutionnelle et le recours aux technologies de l'information et de la communication par l’industrie du sexe séquencent les rapports prostitutionnels, tout en maximisant l’ordre et la rentabilité des activités prostitutionnelles. Sur ce point, le séquencement du processus d’exploitation sexuelle par l’implication de néoproxénètes permet la compartimentation des violences prostitutionnelles voilant leurs sources et leur unicité (MacKinnon, 1987), c’est-à-dire l’appropriation de classe des femmes par la classe des hommes. Pour le dire autrement, en fractionnant le processus d’exploitation sexuelle des femmes, les modes de « gérance du travail du sexe » masquent les violences structurelles et systémiques envers les femmes-prostituées.
Contraintes à la prostitution
Pour recadrer les analyses présentées par le projet de recherche « Repenser la gérance du travail du sexe », exposons maintenant le contexte d’appropriation du corps et de la sexualité des femmes dans lequel s’inscrit la prostitution en l’articulant avec le mariage et le travail salarié des femmes.
Le sexage est un système d’appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes qui a des dimensions matérielles et idéelles (Guillaumin, 1978). Dans cette perspective, il existe deux formes d’usage sexuel exprimant l’appropriation de la classe des femmes : d’une part, l’usage sexuel non monnayé s’inscrivant dans une appropriation individuelle à l’intérieur du mariage et, d’autre part, l’usage sexuel monnayé s’inscrivant dans une appropriation collective délimitée. Plus précisément, dans le mariage, il y a une appropriation des femmes en tant que réservoir de force de travail à travers les charges domestiques et d’entretien physico-affectif des membres du réseau familial et social, l’imposition d’obligations sexuelles et de grossesses, puis l’appropriation du temps et des produits du corps des femmes. La surface institutionnelle du mariage cache le rapport généralisé de l’appropriation des femmes, car ce n’est pas seulement l’épouse qui est appropriée, mais « la classe des femmes en usufruit à chaque homme, et particulièrement à chacun de ceux qui ont acquis l'usage [individuel] de l'une d'entre elles. ». (Guillaumin, 1978 : 20). Assignées aux soins physico-affectifs des membres de la société, la classe des femmes cumule les heures salariées et non-salariées pour ces tâches. Absorbées ainsi dans d’autres individualités, elles se trouvent, en tant que classe appropriée matériellement, privées de la leur ce qui les dépossèdent mentalement d’elles-mêmes.
Puisque qu’elle est appropriée comme machine-à-force-de-travail, l’appropriation de la classe des femmes s’étend à leur force de travail productive et reproductive (Kergoat, 2012). Découlant des rapports sociaux de sexe, la division sexuelle du travail s’opère sous « deux principes : le principe de séparation (il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail d’hommes ̎ vaut ̎ plus qu’un travail de femme) » (Kergoat, 2000 : 35). Sous ce rapport, ce n’est pas uniquement le travail (re)productif des femmes dans la division sexuelle du travail qui est approprié dans le marché du travail, mais les femmes elles-mêmes.
L’analyse du travail des femmes dans le domaine du service à la clientèle permet d’illustrer la forme que peut prendre l’appropriation des femmes sur le marché du travail. Organisé selon les comportements de la clientèle, le travail des femmes dans ces emplois du secteur tertiaire nécessite un travail émotionnel et l’entretien d’un rapport social. C’est pourquoi, les employeurs exercent un contrôle sur l’attitude et les activités émotives des travailleuses afin qu’elles produisent et composent avec les états émotifs de la clientèle. Puisque dans ce travail sexué « le corps de la travailleuse est aussi instrumentalisé dans la production du service, la plupart du temps pour inciter à la consommation ou pour attirer la clientèle », il doit être discipliné avec des uniformes, des codes d’habillement et de conduite et des règles de maquillage. Ainsi, pour avoir accès à un emploi ou pour le maintenir, la travailleuse doit s’assurer que son corps correspond aux critères de « présentation attirante » (Soares, 1998).
En contexte de néolibéralisme mondialisé et à l’aune du sexage, la majeure partie de la classe des femmes doit se mettre en vente sur le marché du mariage ou du concubinage, avoir un emploi de femme sur le marché du travail ou sinon être mise en vente sur le marché sexuel et du sexe afin d’essayer d’obtenir un revenu nécessaire à son existence et à celle des enfants ou personnes dont elle a la charge (Tabet, 1985 ; Guillaumin, 1978 ; Kergoat, 2000 ; Falquet et al., 2010 ; Rich, 1981 ; Delphy, 1970).
C’est en ce sens que les mécanismes d’exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales se trouvent liés à ceux d’exploitation maritale, ainsi qu’à ceux de l’exploitation salariée des femmes. Dans Femmes de droite, Andrea Dworkin relève l’imbrication du mariage, du travail salarié et de la prostitution dans l’appropriation des femmes :
Dans toutes leurs institutions du pouvoir, les hommes s’appuient sur le labeur sexuel et la subordination sexuelle des femmes. Ce labeur doit être maintenu ; et les salaires systématiquement bas des femmes versés pour un travail sans connotation sexuelle forcent effectivement les femmes à vendre du sexe pour survivre. Le système économique qui paie les femmes moins que les hommes va jusqu’à pénaliser celles qui travaillent en dehors du mariage ou de la prostitution, puisqu’en plus de trimer dur pour ces bas salaires, elles doivent quand même vendre du sexe. Ce système qui punit les femmes qui travaillent à l’extérieur de la chambre à coucher en les sous-payant contribue de beaucoup à entretenir chez elle le sentiment que le service sexuel des hommes fait nécessairement partie de la vie d’une femme (Dworkin, 2012 : 72).
La prostitution : au bénéfice de la classe des hommes et au détriment de la classe des femmes
Précisément, le système prostitutionnel repose sur l’appropriation collective d’un groupe de femmes dans un cadre, rémunéré ou non, d’imposition des charges sexuelles et physico-affectives de la classe des hommes. À l’instar du mariage, dont la « forme individualisée [d’appropriation des femmes] contribue par son apparence banale de contractualité à cacher le rapport réel qui existe entre les classes de sexe autant qu'à le révéler » (Guillaumin, 1978 : 34), présenter la prostitution comme une suite consentante de « relations de travail » tend à masquer les rapports réels entre les (néo)proxénètes, les clients-prostiteurs et les femmes-prostituées. L’accroissement et la spécialisation de l’offre dans l’industrie du sexe, de même que le séquencement et la hiérarchisation de ses processus de gestion et d’encadrement illustrent la volonté des (néo)proxénètes de maintenir et renforcer la demande, de manière à accroître leurs revenus (Jeffreys, 2009). Autrement dit, la conceptualisation de la « travailleuse du sexe » comme une entreprise prostitutionnelle offrant des services dissimule son appropriation en tant service sexuel offert par les (néo)proxénètes aux clients-prostitueurs, et ce, au bénéfice de la classe des hommes (ATTAC, 2008 ; Audet, 2005).
Devant composer avec les violences inhérentes à la prostitution (MacKinnon, 2005), les femmes-prostituées doivent également assurer la satisfaction des clients-prostitueurs et répondre aux injonctions des (néo)proxénètes. Les actes, méthodes et structures prostitutionnelles, c’est-à-dire la transformation de femmes en services sexuels, forment un processus de marquage du corps, de la sexualité et de l’individualité des femmes-prostituées menant à la dépossession d’elles-mêmes. En effet, dans les rapports prostitueurs/prostituées et (néo)proxénètes/prostituées, les femmes-prostituées doivent adopter une série de stratégies visant à aménager les séquelles des rapports prostitutionnels, au premier desquelles, la distanciation, qui sépare leur identité personnelle de la prostitution; le désengagement, menant à l’établissement d’une distance émotionnelle entre elles-mêmes et la prostitution; la dissociation, représentant un clivage de personnalité permettant de se conformer à la satisfaction sexuelle des clients-prostitueurs et aux exigences des (néo)proxénètes, et enfin la désincorporation, qui est marquée par des dissociations psychiques et des anesthésies corporelles (Conseil du Statut de la femme, 2012).
Dressage prostitutionnel
Afin d’exposer la décontextualisation et la dématéralisation des rapports prostitutionnels par le projet de recherche « Repenser le travail de gérance du travail du sexe », analysons maintenant les méthodes de contrôle et de surveillance des (néo)proxénètes et des clients-prostiteurs exercées sur les femmes-prostituées.
Le concept de « dressage au coït » développé par Paola Tabet (1985) exprime les contraintes psychiques, la menace de la violence et l’usage de la force mis en place pour maximiser l’exposition des femmes au coït avec pénétration et éjaculation. En ce sens, le dispositif de dressage prostitutionnel mis en place par les (néo)proxénètes est composé de stratégies de surveillance et de contrôle qui ont pour objectifs de maximiser la profitabilité des femmes-prostituées et la satisfaction des clients-prostitueurs.
Tout comme la domestication de la sexualité des femmes à des fins reproductives, la spécialisation de la sexualité d’un groupe de femmes à des fins commerciales et non reproductives découle de « moments techniques d’interventions ponctuelles » (Tabet, 1985) visant la productivité et l’obéissance des femmes-prostituées. Parmi ces interventions, on retrouve la surveillance des forums de discussion des clients-prostitueurs par des (néo)proxénètes afin de s’assurer que les femmes-prostituées représentent conformément l’image de l’entreprise ou y faire la publicité des « filles » et celle de l’entreprise.
Pour minimiser les entraves pouvant troubler le système prostitutionnel, l’industrie applique aussi de multiples types de sanctions lors de la non-conformité des femmes-prostituées aux codes de conduites : violences des (néo)proxénètes - allant des sanctions monétaires au meurtre, contrôle constant du déplacement des femmes-prostituées, imposition d’une cadence prostitutionnelle, contrôle de l’argent et violence des clients-prostitueurs (Bruckert, 2013 ; Jeffreys, 2009 ; Poulin, 2004). Dans ces conditions, le fractionnement de la structuration des actes de gestion, de maintenance et de promotion de la prostitution diversifie et accroît le dispositif de contrôle et de surveillance du corps, de la sexualité et de l’individualité des femmes-prostituées. Ce panoptisme induit chez les femmes-prostituées un état de surveillance permanent - même si son action est discontinuée, tout en les accoutumant à l’ordre et à l’obéissance (Foucault, 1975).
Panoptisme prostitutionnel
Le contrôle et la surveillance des femmes-prostituées par les (néo)proxénètes s’exerce aussi à travers leur contribution financière ou leur implication dans les associations ou organismes dits de « travailleuses du sexe ». Par exemple, la clinique St. James « par et pour les travailleuses du sexe » de San Francisco a reçu des dons de proxénètes lors d’une levée de fond intitulée « Journée de santé érotique » qui a rassemblé la communauté du divertissement adulte, incluant des propriétaires d’établissements prostitutionnels (Koyama, 2004). En retour, ces derniers peuvent obtenir un crédit d’impôt et un siège au conseil d’administration (Koyama, 2004). De cette manière, ils peuvent promouvoir leurs intérêts liés à la santé des femmes-prostituées, en n’amenant aucune modification concrète dans leur gestion de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales tout en s’assurant d’infiltrer un espace « pour les travailleuses du sexe ».
Un autre exemple de la mainmise des (néo)proxénètes sur le mouvement des « travailleuses du sexe » est la création du site web pro-travail et industrie du sexe « Turn off the blue light », conçu en réplique au site « Turn off the red light », par la même compagnie ayant mis en ligne un site prostitutionnel contrôlé par Peter McCormick, un proxénète multimillionnaire (Marr, 2012b). Dans le même ordre d’idées, Douglas Fox, qui se présente comme « un travailleur du sexe» et qui milite à l’International Union of Sex Workers (IUSW), une branche reconnue du Britain’s General Union, est le fondateur et le copropriétaire d’une importante agence d’escortes au Royaume-Uni (Elliot, 2009 ; Marr, 2012a).
Plusieurs organisations de « travailleuses du sexe» ont été fondées par des personnes ayant été reconnues coupables de proxénétisme ou ne cachant pas leurs activités de proxénétisme. La première organisation du genre, Whores, Housewives and Others (WHO), qui est maintenant nommée « Call Off Your Old Tired Ethics » (COYOTE) a été créé aux États-Unis par une femme reconnue coupable de diriger un lieu prostitutionnel en 1962. The Sex Workers’ Outreach Project USA (SWOP USA) a été fondée par Robyn Few, reconnue coupable de conspiration en vue d’activités de proxénétisme (« conspiracy to promote prostitution »). Au mépris des conflits d’intérêts, Prostitutes of New York (PONY) prétend aussi rejoindre les femmes-(néo)proxénètes (Marr, 2012a et 2012b).
Dans le contexte canadien, deux des trois requérantes dans la contestation de plusieurs articles concernant la prostitution, actuellement en attente d’une décision de la Cour Suprême, ont aussi été des proxénètes. Terri Jean Bedford a été reconnue coupable de proxénétisme et Valerie Scott souhaite le redevenir, s’il y a une décriminalisation. Cette dernière milite dans le Sex Professionals of Canada (SPOC) qui décrit les propriétaires d’agences incall ou outcall comme étant les employés des « travailleuses du sexe » (Marr, 2012a et 2012b ; Guiraud et Gastrein, 2011). Il faut souligner que le fondateur du Bunny Ranch, une agence incall du Nevada, prévoit étendre ses activités au Canada dépendamment de la décision de la Cour Suprême :
« Nous surveillons la situation de près parce que dès que nous verrons que ça va être légalisé, comme il se doit, le Bunny Ranch arrivera, et nous arriverons en force » (Blanchfield, 2013).
En somme, la récupération et l’instrumentalisation des termes « travailleuse ou travailleur du sexe» par des (néo)proxénètes et leur incursion dans les organisations de «travailleuses du sexe» illustre leurs initiatives de neutralisation de l’antagonisme des rapports prostitutionnels et d’emprise sur les femmes-prostituées dans la sphère hors-industrie du sexe. Pour banaliser, normaliser et accroître l’expansion de l’industrie du sexe, les (néo)proxénètes créent l’illusion que leurs intérêts sont les mêmes que ceux des femmes-prostituées puisqu’ils supportent la santé sexuelle et les revendications des « travailleuses du sexe » (ATTAC, 2008 ; Ricci et al., 1975).
La résistance féministe abolitionniste
Avant de conclure, rappelons que des féministes et divers groupes alliés résistent et font face au système prostitutionnel depuis l’émergence du mouvement abolitionniste vers la fin du 19e siècle. En 1871, la Commune de Paris avait supprimé le Bureau des Mœurs et mis fin aux activités de 19 lieux prostitutionnels dans plusieurs arrondissements de Paris en les considérant comme semblables à la traite des Noirs et en refusant «l’exploitation commerciale de créatures humaines par d’autres créatures humaines». Il semblerait que de nombreuses femmes prostituées avaient pris les armes avec les révolutionnaires. Cependant, des réactionnaires et des hommes que l’on qualifierait maintenant d’antiféministes sont épisodiquement parvenus à mettre en place des politiques répressives sur les femmes-prostituées (Guiraud et Gastrein, 2011). À ce sujet, Louise Michel, militante anarchiste et féministe, écrivait dans ses mémoires :
Et si, quand une pauvre fille (…) s’aperçoit où elle est, et se trouve dans l’impossibilité d’en sortir, elle étranglait de ses mains vengeresses un des misérables qui l’y retiennent ; si elle mettait le feu à ce lieu maudit, cela vaudrait mieux que d’attendre le résultat des plaidoiries à ce sujet... (Guiraud et Gastrein, 2011).
Lors de la Révolution espagnole de 1936, l’organisation anarchiste et féministe Mujeres Libres a fait de la propagande auprès des hommes et fondé « des centres libératoires de la prostitution » pour les femmes-prostituées qui souhaitaient sortir du système prostitutionnel. Appuyé par d’autres groupes anarchistes, malgré leur machisme de sauveur (Alpi, 2010), elles combattaient la prostitution, alors que certains groupes anarchistes et progressistes focalisaient sur leur syndicalisation (Ackelsberg, 2005 ; Alpi, 2010). Cette vision syndicaliste de l’exploitation sexuelle peut, à la lumière de ce rappel historique, être analysée comme une forme de paternalisme faisant prévaloir les expériences d’organisation du travail ou de militance des gauchistes et des anarchistes sur l’expérience des femmes dans l’exploitation sexuelle et des féministes organisées en non-mixité pour faire face à l’oppression des hommes.
En 1978, a lieu la première conférence féministe sur la pornographie à San Francisco et, l’année suivante, une manifestation à New York sur Times Square rassemblant 5000 femmes et quelques alliés protestant contre l’industrie du sexe et l’exploitation sexuelle (Whisnant, 2012). C’est à la fin des années 70 qu’apparait dans le mouvement féministe une division manifeste quant à la question de la prostitution avec le féminisme s’autoproclamant « pro-sexe », et considérant la prostitution et la pornographie comme un espace de combat ou une industrie ayant un potentiel revendicateur et émancipateur, ou du moins rémunérateur, pour les femmes (Jeffreys, 2009; Whisnant, 2012). D’ailleurs, c’est dans ce contexte que le mouvement néoréglementariste et des « travailleuses du sexe » commencent à s’organiser (Cybersolidaires, 2011).
C’est aussi à cette époque des années 1960-1970 que la compagnie Playboy a entrepris de revaloriser son image, notamment suite aux attaques des féministes abolitionnistes. Elle a financé et promu à coups de milliers de dollars des organisations de lutte pour le droit à l’avortement, contre le sida et d’aide aux victimes de viol par l’entremise de sa fondation, puis a aidé le financement de garderies (Wallechinsky et Wallace, 1981). La Fondation Playboy a aussi financé le travail de l’American Civil Liberties Union (ACLU) sur les droits des femmes (Pitzulo, 2008). Il est difficile de ne pas voir dans de telles initiatives une stratégie d’étouffement de la résistance des féministes face à la prostitution et à la pornographie.
Pistes féministes abolitionnistes
En focalisant l’attention sur les lois, la stigmatisation, les stéréotypes et les préjugés concernant la prostitution plutôt que sur ses violences inhérentes et son insertion dans un continuum d’appropriation et d’exploitation des femmes, il est possible de penser en termes de perfectibilité du système prostitutionnel. Au-delà de la présentation du contexte et du contenu du livret « Gérer le travail du sexe : information pour les tierces personnes et les travailleuses du sexe des secteurs incall et outcall », la présente contribution visait à recontextualiser et rematérialiser l’analyse des structures et des rapports prostitutionnels en tant que mode d’appropriation et d’exploitation du corps, de la sexualité et de l’individualité de la classe des femmes. L’objectif était aussi de cerner les rapports de force traversant le courant néoréglementariste et les stratégies qu’il utilise. La mise au jour des tactiques idéologiques et pratiques des défenseurs et défenseuses de l’industrie du sexe mérite d’être poursuivie. Elle permet de préciser les obstacles et les cibles de l’épistémologie, de la mobilisation, de l’action et de l’intervention féministe néoabolitionniste, ainsi que d’alimenter la combattivité de ce mouvement puisque :
Contrainte, certes, exploitée, sans le moindre doute, pas libre,
c'est évident, mais pas objet matériel approprié,
pas «chose», ça certainement pas ! Voilà le
grand fantasme que nous déployons dans notre cinéma inconscient.
Pourtant, dans les rapports de classes de sexe c'est exactement ce que
nous sommes : des vaches, des chaises, des objets. Non pas métaphoriquement
comme nous essayons de le suggérer et de le croire (lorsque nous
parlons d'échange des femmes ou de réappropriation de notre
corps...) mais banalement. Et pour nous aider à cultiver ce fantasme
et à nous faire avaler sans réagir cette relation, pour
la faire passer en douceur et tenter de nous empêcher d'y voir clair,
tous les moyens sont bons. Même les histoires. Depuis la passion
jusqu'à la tendresse, depuis le silence prudent jusqu'au mensonge
caractérisé, et de toutes façons, des fleurs, des
décorations, toujours disponibles pour couronner le front du bétail
les jours de fêtes ou de foires. Et si cela ne suffit pas (et cela
ne suffît pas en effet), de la violence physique à la Loi,
il y a encore moyen de tenter de nous empêcher de nous en mêler
(Guillaumin, 1978 : 28).
Bibliographie
Ackelsberg, Martha A. 2005. Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. Oakland : AK Press, 286 p.
Alpi, Fred. 2010. « Les mujeres libres : des femmes espagnoles en lutte contre le patriarcat et contre le fascisme en Espagne entre 1936 et 1939 » Barricata. No 21. En ligne. <http://www.fredalpi.com/spip/spip.php?article81>. Consulté le 19 juin 2013.
ATTAC. 2008. Mondialisation de la prostitution, atteinte globale à la dignité humaine. Montreuil-sous-Bois : les éditions Mille et une nuits, 112 p.
Audet, Élaine. 2005. Prostitution, perspectives féministes. Montréal : Sisyphe, 120 p.
Blanchfield, Mike et Martin Dufresne (trad.) 2013 (21 juin). « Un patron de bordel américain prêt à « bondir au Canada » si la Cour suprême invalide la loi sur la prostitution». Sisyphe. En ligne. ˂http://sisyphe.org/spip.php?article4451˃. Consulté le 5 juillet 2013.
« Bordel Allemagne (traduction) ». 2013 (2 juin). Dans ANgrywOmeNYMOUS. En ligne.
<http://angrywomenymous.blogspot.fr/2013/06/bordel-allemagne traduction.html?spref=tw>. Consulté le 18 juillet 2013.
Bouffartigue, Paul, Danièle Linhart et Aimée Moutet (dir.) 2005. « Le travail nous est compté : la construction des normes temporelles au travail ». Temporalités. En ligne. No.3. <http://temporalites.revues.org/493> Consulté le 15 juin 2013.
Bruckert, Chris et al. 2013. « Gérer le travail du sexe : information pour les tierces personnes et les travailleuses du sexe du secteur incall et outcall », in Global Network of Sex Work Projects. En ligne.
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/UOOLivretGererLeTravailDuSexeWeb.pdf˃. Consulté le15 juin 2013.
Chambre des communes du Canada (Comité permanent de la justice et des droits de la personne). 2006. Le défi du changement : étude des lois penales en matière de prostitution au Canada. Rapport du Sous-comité de l’examen des lois sur le raccolage, Ottawa : Chambres des communes du Canada. En ligne
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/committee/391/just/reports/rp2599932/justrp06/sslrrp06-f.pdf˃. Consulté le 18 juin 2013.
Clinique de Sexothérapie. s.d. « Pascale Robitaille : Sexologue clinicienne M.A. ». In Clinique de Sexothérapie : Promotion du bien-être et de la santé sexuelle. En Ligne. <http://www.sexotherapie.ca/fr/pascale-robitaille>. Consulté le 20 juin 2013.
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES). 2011. « Pour l’égalité de fait pour toutes : une politique de lutte contre l’exploitation sexuelle de l’image et du corps des femmes et des filles. » En ligne. 23 p. <http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_43615&process
=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz>. Consulté le 10 juin 2013.
Concordia University. 2013. « Jenn Clamen ». Dans Simone de Beauvoir Institute : Faculty and Staff. En ligne. <http://wsdb.concordia.ca/faculty-and-staff/faculty/clamen.php>. Consulté le 20 juin 2013.
Conseil du statut de la femme. 2012. Avis. La prostitution : il est temps d’agir. En ligne. 154 p.
<http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf>. Consulté le 16 juin 2013.
Delphy, Christine. 2008. Économie politique du patriarcat. t.2 de L’ennemi principal. Coll. « Nouvelles questions féministes ». Paris : Éditions Syllepse, 296 p.
« Dossier prostitution : Trois grandes tendances ». 2010 (10 septembre). Dans Alternative libertaire. En ligne. Numéro 197 (juillet-août).http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article3679. Consulté le 20 juin 2013.
Dworkin, Andrea. 2012. Les femmes de droite. Montréal : Éditions du remue-ménage, 250 p.
Elliot, Cath. 2009 (9 janvier). « The great IUSW con ». Message envoyé à Too Much to Say for Myself. En ligne. <http://toomuchtosayformyself.com/2009/01/09/the-great-iusw-con/>. Consulté le 17 juin 2013.
Falquet, Jules, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Le Feuvre et Fatou Sow. 2010. Le sexe de la mondialisation : Genre, classe, race et nouvelle division du travail. Paris : Presses de Sciences Po, 278 p.
Filles électriques. 2013 (9 juillet). « Émilie Laliberté ». Dans Festival voix d’Amérique: Artiste. En ligne.
<http://www.fva.ca/filles/fr/select/bio/?id=laliberte_em>. Consulté le 9 juillet 2013.
Fondation Scelles. 2009 (28 juillet). « La formule " forfait illimité" des centres de prostitution en Allemagne », dans Fondation SCELLES infos : Archives. En ligne. <http://infos.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:la-formule-forfait-illimite-des-centres-de-prostitution-en-allemagne&catid=19:archives&Itemid=204>. Consulté le 16 juin 2013.
Foucault, Michel. 1994. Surveiller et punir : Naissance de la prison. Coll. « Tel ». Paris : Gallimard, 318 p.
Geadah,Yolande. 2003. La prostitution : un métier comme un autre ? Montréal : VLB éditeur, 294 p.
Guillaumin, Colette. 1978. « Pratiques du pouvoir et idée de Nature. (1) L’appropriation des femmes ». Questions féministes : les corps appropriés. En ligne. No. 2, (février), p.5-30. JSTOR. ˂http://www.jstor.org/stable/40619109˃.Consulté le 11 juin 2013.
Guillaumin, Colette. 1979. « Question de Différence ». Questions féministes : Les dits - faits - rances. En ligne. no 6, p. 3-21. JSTOR. < http://www.jstor.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/stable/40619152?origin=JSTOR-pdf >. Consulté le 11 juin 2013.
Guiraud, Élise et Philippe Gastrein. 2011 (janvier). « Louise Michel, la Commune de Paris et la prostitution ». Dans Prostitution et société : le site de la revue trimestrielle du Mouvement du Nid-France. En ligne.
<http://www.prostitutionetsociete.fr/cultures/histoire/louise-michel-la-commune-de-paris>. Consulté le 18 juin 2013.
Héritier, Françoise. 1996. Masculin/féminin : La pensée de la différence. Paris : Éditions Odile Jacob, 332 p.
Institut Simone de Beauvoir. 2010. Déclaration de l’Institut Simone de Beauvoir : Une prise de position féministe sur le travail du sexe En ligne. 6 p. <http://cybersolidaires.typepad.com/files/declaration_sex-work_02.11.2010.pdf> Consulté le 17 juin 2013.
Jeffreys, Sheila. 2009. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Sex Trade. Londres : Routledge, 244 p.
Kergoat, Danièle. 2012. Se battre disent-elles…. Paris : La Dispute, coll. « Le genre du monde », 353 p.
_________. 2009. « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux ». Dans Sexe, race, classe : Pour une épistémologie de la domination, sous la dir. d’Elsa Dorlin, p.111-125. Paris : Puf/Actuel Marx Confrontation.
__________. 2000. « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe ». Dans Dictionnaire critique du féminisme. En ligne. <http://fr.scribd.com/doc/47533482/Division-sexuelle-du-travail-et-rapports-sociaux-de-sexe>. Consulté le 15 juin 2013.
Knox, Carsten. 2010. « Best Fighter of the Good Fight: Rene Ross », The Coast: Halifax’s website. En ligne.
<http://www.thecoast.ca/halifax/best-fighter-of-the-good-fight/BestOf?oid=1976874>. Consulté le 14 juin 2013.
Koyama, Emi. 2004 (22 novembre). « Pimps Are Not Our Friends : sex worker’s clinic should distance itself from managers ». Dans eminism.org : Putting the Emi back in Feminism since 1975. En ligne. <http://eminism.org/interchange/2004/20041122-prodecrim.html>. Consulté le 14 juin 2013.
Koyama, Emi. 2012 (30 mai). « Not so quick to call sex worker activists “pimps”: criminal charges do not tell the full story ». Message envoyé à feminism.org : Putting the Emi back in Feminism since 1975. En ligne. <http://eminism.org/blog/entry/311>. Consulté le 14 juin 2013.
Lamont, Ève. 2010. Le plus vieux mensonge du monde. Documentaire. Montréal : Les Productions du Rapide-Blanc. DVD, 54 min.
Legardinier, Claudine et Elise Guiraud. 2013 (4 juillet). « Canada : La justice se prononce en faveur des proxénètes », Prostitution et Société : site web de la revue trimestrielle du Mouvement du Nid-France. En ligne. http://www.prostitutionetsociete.fr/politiques-publiques/legislations-nationales/canada-la-justice-se-prononce-en>. Consulté le 5 juillet 2013.
« L’histoire du mouvement des travailleuses du sexe ». 2011 (25 juin). Dans Cybersolidaires. En ligne. <http://cybersolidaires.typepad.com/ameriques/2002/03/lhistoire_du_mo.html>. Consulté le 16 juin 2013.
Lowman, John. 2001. Des lacunes en matière de recherche dans la littérature sur la prostitution. En ligne. 31 p.
<http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sjp-jsp/rr02_9/rr02_9.pdf>. Consulté le 16 juin 2013.
MacKinnon, Catharine. 2005 (1987). « Sexualité et violence. Question de point de vue », Dans Le féminisme irréductible : Discours sur la vie et la loi, p.87-95. Paris : les Éditions des femmes.
Marr, Stella. 2012. « Pimps Will Be Pimps Whether Male or Female or Posing as “Sex Worker Activists” & Other Conflicts of Interest (Part 1 of 2) », Prostitution Research & Education: Abolish Prostitution and Provide Alternatives. En ligne. <http://prostitutionresearch.com/pre_blog/2012/05/23/pimps_will_be_pimps_whether_ma/>. Consulté le 14 juin 2013.
Marr, Stella. 2012. « Pimps Will Be Pimps Whether Male or Female or Posing as “Sex Worker Activists” & Other Conflicts of Interest (Part 2 of 2). », Prostitution Research & Education: Abolish Prostitution and Provide Alternatives. En ligne. <http://prostitutionresearch.com/pre_blog/2012/06/28/pimps_will_be_pimps_part_2_of/> Consulté le 14 juin 2013.
Navarro Swain, Tania. 2011. (26 avril). «La prostitution : violence sociale et historique contre les femmes». Message envoyé à Mauvaiseherbe’s Weblog. En ligne. <http://mauvaiseherbe.wordpress. com/2011/04/26/la-prostitution-violence-sociale-et-historique-contre-les-femmes/>. Consulté le 10 juin 2013.
« Pimps behind “Sex-Positive” Campain to Legalize Prostitution ». 2012 (10 septembre). Message envoyé à tHE rHizzonE : Laissez’s Faire. En ligne. <http://www.rhizzone.net/forum/topic/2153/>. Consulté le 18 juin 2013.Pitzulo, Carrie. 2008. «The Battle in Every Man's Bed: Playboy and the Fiery Feminists». Journal of the History of Sexuality. En ligne. Vol. 17, No. 2, p. 259-289. Dans Projet Muse. ˂http://muse.jhu.edu/journals/sex/summary/v017/17.2.pitzulo.html>. Consulté le 16 juin 2013.
Poulin, Richard. 2011 (30 juin). « La légalisation de la prostitution et ses effets sur la traite des femmes et des enfants », Sisyphe. En ligne. http://sisyphe.org/spip.php?article1565 . Consulté le 12 juin 2013.
__________. 2004. La mondialisation des industries du sexe : Prostitution, pornographie, traite des femmes et des enfants. Ottawa : L’Interligne, 248 p.
Ricci, François et al. 1975. Gramsci dans le texte : de l’avant aux derniers écrits de prison (1916-1935). Paris : Éditions sociales, 798 p.
Ricci, Sandrine, Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy. 2012. « La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle : entre déni et invisibilité ». Les Cahiers de l’IREF. Coll. « Agora », no 4. Montréal : UQAM, 218 p.
Rich, Adrienne. 1981. « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne ». Nouvelles questions féministes. En ligne. No.1, (mars), p. 15-44. JSTOR. ˂http://www.jstor.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/stable/40619205> . Consulté le 21 juin 2013.
Soares, Angelo. 2001. « Les qualifications invisibles dans le secteur des services : le cas des caissières de supermarchés ».Lien social et politiques Riac, n˚ 40, p. 105-116. En ligne.
http://www.angelosoares.uqam.ca/upload/files/Articles-avec-comite-de-lecture/Les_qualifications_invisibles_dans_le_secteur_des_services.pdf>. Consulté le 17 juin 2013.
Spears, Tony. 2013. « Future of Prostitution in Hands of Supreme Court ». Ottawa Sun (8 juin). En ligne.
<http://www.ottawasun.com/2013/06/08/future-of-prostitution-in-hands-of-supreme-court>. Consulté le 13 juin 2013.
Stella, l’amie de Maimie. 2011 (14 septembre). « Des groupes de femmes proposent de combattre le travail du sexe… par la violence ». Message envoyé à Cybersolidaires. En ligne. <http://cybersolidaires.typepad.com/ ameriques/2011/09/des-groupes-de-femmes-proposent-de-combattre-le-travail-du- sexe-par-la-violence.htm Consulté le 17 juin 2013.
Tabet, Paola. 1985. « Fertilité naturelle, reproduction forcée ». Dans L’arraisonnement des femmes : Essais en anthropologie des sexes sous la dir. de Nicole-Claude Mathieu, p. 61-85. Paris : Éditions de l’école des hautes études en sciences sociales.
Université du Québec à Montréal.2013. Faculté des sciences humaines : École de Travail Social. En ligne.
<http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/default.aspx> Consulté le 20 juin 2013.
Université d’Ottawa : Faculté des sciences sociales. s.d. « Repenser le travail de gérance dans l’industrie du sexe ». En ligne. <http://www.sciencessociales.uottawa.ca/gis-msi/fra/index.asp>. Consulté le 16 juin 2013.
University of New Brunswick. s.d. « Dr. Leslie Jeffrey », UNB Saint John Faculty of Arts: People. En ligne.<http://www.unb.ca/saintjohn/arts/depts/historypolitics/people/jeffrey.html>. Consulté le 20 juin 2013.
Université d’Ottawa. s.d. « Corps professoral : Colette Parent. », Faculté des sciences sociales : département de criminologie. En ligne. <http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crm/profil-professeur?id=30 > Consulté le 20 juin 2013.
__________. « Corps professoral : Patrice Corriveau. », Faculté des sciences sociales : département de criminologie. En ligne. <http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crm/profil-professeur?id=15>. Consulté le 20 juin 2013.
Wallechinsky, David et Irving Wallace. s.d. « History of Playboy Magazine Part 4 : About the history of Playboy magazine examples of content, size, strengths and weaknesses », Trivia Library. En ligne. ˂http://www.trivia-library.com/c/history-of-playboy-magazine-part-4.htm>Consulté le 10 juin 2013.
Whisnant, Rebecca. 2012 (3 mai). « Le féminisme contemporain dans la culture porno : ni le playboy de papa, ni le féminisme de maman », Sisyphe. En ligne. http://sisyphe.org/spip.php?article4191. Consulté le 10 juin 2013.
Annexe
L’équipe de recherche du projet « Repenser le travail de gérance dans l’industrie du sexe ».
Chris Bruckert, la chercheure principale, est professeure au département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Elle a dévoilé avoir été danseuse nue entre la fin des années 1970 et le début des années 1980[9]. Elle a écrit plusieurs textes en collaboration avec Colette Parent, notamment « La danse érotique comme métier à l'ère de la vente de soi » (Cahiers de recherche sociologique UQAM) et « Le Travail du sexe dans les établissements, érotiques : une forme de travail marginalisé » (Déviance et Société). De 2008 à 2011, elle est présidente de l’organisme POWER. Maintenant, elle y occupe le poste de vice-présidente.
Chargée de projet et seconde auteure, Jenn Clamen a débuté son implication au sein de l’international Union of Sex Workers in London. Elle a par la suite occupé un poste de responsable à la mobilisation et aux communications à l’organisme Stella (Montréal). Présentement, elle est encore active à l’organisme Stella et elle siège en tant que représentante nord-américaine au conseil d’administration de Global Network for Sex Work Projects. Elle est aussi chargée de cours et chercheure à l’Université Concordia, au sein de l’Institut Simone de Beauvoir qui, d’ailleurs, s’est positionné officiellement pour la décriminalisation de la prostitution en novembre 2010 (CDEACF, 2010; Institut Simone de Beauvoir, 2013).
La troisième co-auteure, Maria Nengeh Mensah, est professeure à l’École de travail social et à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal. Active sur le plan universitaire et communautaire, elle a créé durant la dernière décennie divers outils à l’intention des intervenants et intervenantes des services publics ou communautaires, de la police et divers acteurs et actrices œuvrant dans le système de justice, les médias et la sphère municipale. À titre d’exemple, elle est chercheure principale du projet « SENSIBILISATION XXX AWARENESS - Stigmatisation et travail du sexe : comprendre les enjeux, pluraliser le discours et créer des lieux d'échanges et de solidarités » (Université du Québec à Montréal, 2013).
L’équipe de recherche est aussi composée du co-chercheur Patrice Corriveau et des co-chercheuses Leslie Jeffrey et Colette Parent. Avant de joindre le Département de criminologie de l'Université d'Ottawa, Patrice Corriveau occupait le poste d'analyste principal des politiques pénales du ministère de la Justice du Canada. De plus, il a participé à l’ouvrage Mais oui c’est un travail. Penser le travail du sexe au-delà de la victimisation regroupant Chris Bruckert, Maria Nengeh Mensah, Colette Parent et Louise Toupin.
Professeure de politique comparée et de relations internationales à l’Université du Nouveau-Brunswick, Leslie Jeffrey a produit plusieurs recherches sur la prostitution dont « Sex Workers in the Maritimes Talk Back » avec Gayle MacDonald.
Professeure au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa, Colette Parent, mène depuis vingt ans des recherches sur le « travail du sexe ». Elle a été membre du comité de recherche de l’organisme Stella.
Les personnes assistantes de recherche sont Sébastien Lachambre et Tuulia Law de l’Université d’Ottawa au Département de criminologie.
Le comité communautaire est composé de représentantes de quatre organismes de « travailleuses du sexe » : Maggie’s, Stella, Stepping Stone et POWER.
Kara Gillies représente Maggie’s (Toronto Sex Worker Action Project) où elle occupe le poste de coordonnatrice du Développement et de l’Éducation. Elle a été active dans l’industrie du sexe pendant vingt ans (UofTtix At Hart House, 2004).
L’organisme Stella est représenté par Pascale Robitaille, une sexologue clinicienne, qui en est la coordonnatrice clinique; par Émile Laliberté, coordonnatrice générale, travaillant depuis plus de 7 ans à Stella et ayant été active dans l’industrie du sexe pendant 10 ans (Clinique de Sexothérapie, s.d.; Festival Voix d’Amérique, 2013).
Rene Ross fait partie de l’équipe au nom de l’organisme Stepping Stone (Halifax) dont elle a récemment été la directrice exécutive après avoir siégé à son conseil d’administration (Knox, 2010).
idente de Prostitutes of Ottawa/Gatineau Work, Educate and Resist (POWER) organisant des activités, des ateliers et des formations pour les « travailleuses du sexe » et la communauté (Spears, 2013).
Annexe 2
Appel à la participation
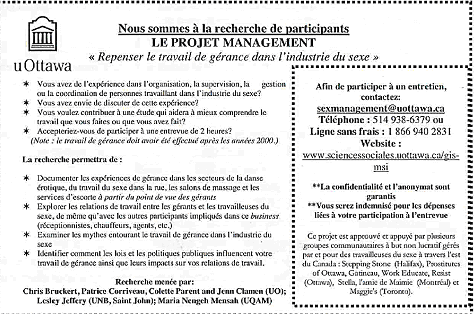
Publié dans le Bulletin Stellaire d’octobre 2010.
>Le bulletin de l'organisme Stella, « par et pour les travailleuses du sexe ».
Notice biographique:
Shanie Roy est une survivante
de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et une militante féministe.
[1] Avec l’aide précieuse de Stéphanie Paradis, étudiante au certificat en études féministes à l’UQAM
[2] Si les personnes trans et intersexes, puis les garçons et les hommes peuvent constituer des groupes sociaux étant et pouvant être prostitués, faut-il rappeler qu’historiquement, la très grande majorité des personnes-prostituées et des personnes-prostituables sont des femmes et des filles et que les clients-prostitueurs sont quasi exclusivement des hommes (CLES, 2011). L’utilisation des expressions « femmes-prostituées », « survivantes » ou « clients-prostitueurs » vise à combattre la neutralisation des rapports sociaux de sexe et à la normalisation de la prostitution.
[3] Le féminisme abolitionniste ou le néoabolitionnisme vise l’abolition de la prostitution en tant système d’exploitation sexuelle profitant à la classe des hommes. À l’origine, le mouvement abolitionniste visait l’abolition des règlementations régissant les femmes-prostituées par l’imposition de contrôles médicaux et policiers (Alternative libertaire, 2010).
[4] En référence à la fois à l’utilisation du terme « coquilles » par Andrea Dworkin lors d’un discours prononcé le 6 décembre 1990, au concept de « dépossession » de Colette Guillaumin et à la notion de « larve » de Nelly Arcan dans son livre Putain.
[5] Au Canada : EVE (formely Exploited Voices now Educating), les survivantes de Indigenous Women Against the Sex Industry (IWASI), Sextrade101, les survivantes de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), les survivantes de la Maison de Marthe. Aux États-Unis : Breaking Free, Standing Against Global Exploitation Project (SAGE Projet), les survivantes de Girls Educational and Mentoring Services (GEMS), Women Hurt In Systems of Prostitution Engaged in Revolt (Whisper), les survivantes de l’Organization for Prostitution Survivors et le Survivor Advisory Caucus de la Coalition to Abolish Slavery & Trafficking. En Irlande: les survivantes de Ruhama. En Afrique du Sud : Masiphakameni (Stand Up). En Inde : Apne Aap Women Worldwide. Aux Philipines : Bagong Kamalayan Collective, Inc. (BKCI). Les groupes internationaux : Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment (SPACE), Sex Trafficking Survivors United et Survivors Connect Network.
[6] La plupart des actrices et acteurs sociaux défendant l’industrie du sexe reprochent aux féministes abolitionnistes de considérer les femmes-prostituées comme des « victimes sans voix ». Cette accusation relève d’une négation des maintes contraintes et répressions qui affectent la militance néoabolitionniste des survivantes ou des femmes-prostituées. Il faut prendre en considération les conditions de militance des survivantes : la charge du vécu prostitutionnel, les réalités socioéconomiques, l’accès à un réseau de solidarité, l’intérêt ou la disponibilité communautaire et médiatique, les attaques envers les féministes abolitionnistes, etc.
[7] Voir les notices biographiques des membres de l’équipe de recherche en annexe.
[9] http://www.ualberta.ca/~lgotell/OB_Articles/ross.pdf

labrys,
études féministes/ estudos feministas
juillet / décembre 2013 -julho / dezembro 2013