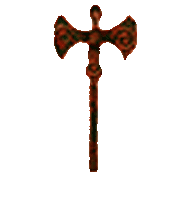labrys, études féministes/
estudos feministas L’exercice de l’agentivité sexuelle par de jeunes femmes : comprendre le débat
Marie-Eve Lang Résumé Le concept d’agentivité sexuelle fait de plus en plus l’objet de débats dans le milieu des études féministes. On ne s’entend pas toujours sur sa définition et on s’interroge souvent sur la possibilité même de pouvoir en exercer dans un contexte social genré et soumis aux normes sexuelles.Suivant la réflexion théorique de l’auteure, le présent article montre que l’exercice de l’agentivité sexuelle par de jeunes femmes est bien possible et Introduction Mots-clés: agentivité sexuelle, études féministesjeunes femmes
Introduction La question de l’exercice de l’agentivité (en d’autres mots, de la possibilité même de pouvoir en exercer) est source de conflits depuis plusieurs décennies au sein de la recherche et notamment de la recherche féministe. Comment les femmes peuvent-elles exercer véritablement de l’agentivité (c’est-à-dire faire des choix estimés libres, et agir selon leur propre vouloir) dans un contexte régulé par un pouvoir masculin que l’on considère comme contraignant et, plus encore, instauré de façon systématique? Il semblerait, lorsqu’il est question d’agentivité, que l’on n’arrive pas à concilier les visions selon lesquelles les femmes sont instituées de pouvoir, d’un côté, et selon lesquelles elles sont soumises aux normes sociales et au patriarcat, de l’autre. Dans ce contexte, comme l’expliquent déjà en 1992 Fraser et Bartky : "[…] either we limn the structural constraints of gender so well that we deny women any agency or we portray women’s agency so glowingly that the power of subordination evaporates. Either way, what we often seem to lack is a coherent, integrated, balanced conception of agency, a conception that can accomodate both the power of social constraints and the capacity to act situatedly against them. (Fraser et Bartky : 1992 : 17, leurs italiques) Ce débat, qui pourtant dure depuis longtemps, n’est toujours pas résolu aujourd’hui; et les positions des deux camps sont encore très polarisées. D’un côté, on retrouve des théoriciennes comme Rosalind Gill (2007, 2008a, 2008b, 2009b, 2010, 2011) qui estiment « nuisible » le concept d’agentivité et qui vont jusqu’à prôner son abolition; de l’autre, on retrouve des chercheuses plus empiriques qui soutiennent et défendent son utilisation (Duits et van Zoonen : 2006, 2007, 2009). Récemment, par exemple, les chercheuses féministes Gill et Scharff ont déploré que les « mots du jour » en recherche féministe soient « choice » et « empowerment » plutôt que « sexisme » (et donc subordination), et que paradoxalement à l’émergence de ce discours semblable à celui du « girl power », que l’on a vu apparaître dans les années 90 et au début des années 2000, l’on assiste, selon leur point de vue, à l’émergence de nouvelles formes d’inégalité entre les sexes et de nouvelles modalités de pouvoir (Gill : 2011, 2009a et b; Gill et Scharff : 2011). Elles craignent notamment que la résurgence de ce type de discours, appuyé par une ligne de pensée qualifiée comme « postféministe » ou « néolibérale », évacue du coup la possibilité de discuter de l’aspect politique de ces inégalités de pouvoir. Elles arguent que par ces discours néolibéraux, l’on offre aux femmes certaines formes de pouvoir et d’empoéwerment qui soient en remplacement des politiques féministes, comme si le discours misant sur le choix et l’empowerment (bref, sur l’agentivité des femmes) ne pouvait fondamentalement être concilié avec le discours féministe plus traditionnellement politique (voir aussi Gill : 2010). Plus encore, elles déplorent que ce type de discours soit « célébratoire » et craignent qu’en portant l’accent sur le choix libre, l’on tienne les femmes « responsables », en quelque sorte, de leur propre sort. Dans ce contexte, la question de l’agentivité sexuelle des femmes, et particulièrement des jeunes femmes et des adolescentes, devient un sujet particulièrement sensible : d’une part, certaines chercheuses féministes déplorent le fait que le néolibéralisme et le postféminisme semblent imposer une nouvelle prescription de contrôle et d’assertivité aux jeunes filles, alors même que le contexte dans lequel elles exercent ce contrôle semble à ces chercheuses imprégné d’inégalités persistantes – où, par exemple, les hommes et les garçons exercent toujours autant de pouvoir et où les filles se retrouvent injustement avec la responsabilité personnelle de contrer ce pouvoir, qui pourtant s’exerce à un niveau beaucoup plus large. D’autre part, d’autres chercheuses cherchent à faire reconnaître la « parole » des filles, leur voix et leur capacité d’action – mais se font critiquer pour le faire (notamment Duits et van Zoonen : 2006, 2007 et 2009). L’une des raisons pour lesquelles le discours néolibéral serait particulièrement néfaste, estiment les chercheuses Harvey et Gill (2011), se situerait dans le fait qu’il ait été insidieusement repris par les médias pour créer un nouveau type de « sujet sexuel » issu d’un enchevêtrement de discours néolibéraux de liberté sexuelle récupérés dans une optique capitaliste et consumériste. Il en résulterait, au final, une figure stéréotypée de la femme qui reprend les vieux clichés sexistes, mais qui a l’apparence d’une nouvelle forme de « pouvoir » et d’expression sexuelle « libre ». Les auteures donnent en exemple les représentations de la sexualité féminine que l’on trouve dans des émissions de téléréalité et dans la publicité, où les femmes sont encouragées à adopter un comportement sexuel calqué sur certains principes de l’agentivité (le fait d’être actif dans sa sexualité, par exemple) et à projeter une allure confiante de façon à séduire (et à garder) leur conjoint ou partenaire. En utilisant de façon particulièrement insidieuse les discours néolibéraux et postféministes, on inviterait donc les femmes à « gérer » leur sexualité de façon à ce qu’elles projettent sans cesse une image d’elles « en charge » de leur sexualité – mais une image qui au final vise principalement à satisfaire les « besoins » sexuels des hommes. En imposant une nouvelle « norme » de la performance à des fins lucratives, ce discours perpétuerait aussi la perception naturaliste de la différence entre les sexes (les hommes auraient naturellement des désirs sexuels qu’il faut impérativement combler par un travail sur les femmes), tout autant qu’il instaurerait une nouvelle « norme » des activités sexuelles souhaitables (masturbation, sexe oral, fantasmes « légers », expérimentation de nouvelles pratiques sexuelles, etc.) et non souhaitables (sexe anal, fétiches, absence de sexualité dans le couple, etc.). On imposerait même aux femmes des attitudes « obligatoires », soit d’être toujours « up for it » et « willing to try » (Harvey et Gill : 2011; voir aussi Gill : 2007, 2008a, 2008b, 2009b, et 2011). Mais ces représentations médiatiques déformées de l’agentivité (bref cette agentivité factice, justement transformée par les médias soumis au modèle publicitaire), impliquent-elles nécessairement que l’expression réelle et non médiatique de l’agentivité soit impossible? Nous pensons que non; et estimons, à la suite, par exemple, de Duits et van Zoonen (2007) et d’Hasinoff (2010), que le fait de concevoir des individus comme étant « agents » n’évacue pas nécessairement la notion de contrainte sociale; au contraire, comme nous allons le voir, chaque action d’un agent est située socialement. En ce sens, l’agentivité des femmes et des filles est nécessairement contrainte par le genre et le patriarcat, et s’exprime dans un monde où les représentations médiatiques de la sexualité sont le résultat et le reflet de cette tension politique pour définir la réalité. Il importe de comprendre que la relation entre agentivité et contraintes sociales ne constitue pas les extrêmes d’une dichotomie binaire et diamétralement opposée, mais constitue une dualité structurelle indivisible (Giddens : 1984). Nous montrons ici que cette idée de coexistence de contraintes sociales et de capacité d’action est non seulement possible, mais déjà présente dans la définition du concept même, et qu’ainsi en ancrant le concept d’agentivité sexuelle à la fois dans la tradition sociologique du développement du concept d’agent et dans le cadre actuel des études empiriques sur la question, l’on se rend compte que cette conciliation permet l’utilisation du concept d’agentivité sexuelle en sciences sociales de façon productive.
L’agentivité en contexteComme l’ont formulé Bereni, Chauvin et al., « le genre est partout » (2008: 76). Cependant, le genre ne détermine (ou ne prédétermine) pas tout; les êtres humains, en ce qu’ils sont capables de réfléchir et de faire des choix, ne sont pas des machines qui réitèrent les structures en place sans jamais les remettre en question. L’acquisition d’habitudes et l’adoption de certains comportements sociaux sont infiniment plus complexes. La part de pouvoir qui revient aux acteurs sociaux, ce serait l’agentivité. Anthony Giddens, qui s’est intéressé à la reproduction de telles structures, mettait de l’avant déjà en 1984 la notion d’acteurs « compétents » (2005 [1984] : 41), c’est-à-dire d’acteurs possédant une « capacité réflexive ». En effet, estime-t-il, les acteurs « sont capables de comprendre ce qu’ils font pendant qu’ils le font; cette capacité est inhérente à ce qu’ils font. » (idem : 33). Cette « capacité réflexive de l’acteur humain » serait, selon lui, « constamment engagée dans le flot des conduites quotidiennes, dans les divers contextes de l’activité sociale » (idem, ib..). Ces activités quotidiennes, même les plus routinières, réactualisent les structures sociales – c’est-à-dire que ce sont les agents qui, par leurs actions, créent les structures et permettent leur réactualisation, et non les structures qui « agissent » de façon contraignante sur les agents. Ainsi donc, les agents, par le fait même d’entreprendre leurs activités quotidiennes, « reproduisent les conditions qui rendent ces activités possibles » (idem : 50). Par leurs choix quotidiens, les acteurs « contrôlent […], de façon routinière, les dimensions sociale et physique des contextes dans lesquelles ils agissent » (p. 54). En ce sens, une action se définit par le fait qu’un acteur aurait pu « agir autrement ». C’est par ce choix, cette capacité d’action, qu’intervient le pouvoir des individus. Bien sûr, ces actions peuvent être contraintes par les structures sociales. Des conséquences sont liées, par exemple, au fait de ne pas se présenter au travail, ce qui peut influencer fortement la décision d’un individu de s’y rendre. Mais « le structurel n’est pas que contrainte », estime Giddens; « il est à la fois contraignant et habilitant » (idem : 75). C’est en reproduisant certaines règles que les acteurs permettent le changement. En d’autres mots, « les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résultat des pratiques qu’elles organisent de façon récursive » (idem ibid.). C’est ce que Giddens nomme « la dualité du structurel ». Bref, selon la perception de Giddens, l’acteur, par sa liberté d’action et ses connaissances des relations humaines et des contraintes qui y sont associées, est capable de contester des normes (p. 319) et même de contrôler les activités d’autrui par la transformation de certaines structures (p. 79). Cette capacité d’action, cette « agentivité », est en ce sens fortement liée au contexte à la fois social, historique et situationnel des individus (Emibayer et Mishe : 1998). En effet, pour bien comprendre la capacité d’action des individus, l’agentivité « must always be understood in context, as a social relation rather than as an absolut fact » (Hasinoff, 2010 : 20). Une telle conception de l’agentivité comme un élément sans cesse soumis à des contraintes permet simultanément de concéder que l’agentivité est soumise à la culture et aux structures sociales en place (comme celles du patriarcat) et de reconnaître l’existence ou même la possibilité même d’existence du pouvoir d’action des individus malgré la présence de ces contraintes. Cela nous apparaît essentiel pour ne pas jeter la reconnaissance de l’agentivité des jeunes femmes, notamment de leur agentivité sexuelle, avec l’eau du bain des débats théoriques sur les limites de son exercice. Car comme nous le verrons, les études empiriques portant sur la question ont bel et bien démontré que les filles étaient capables d’action raisonnée, et la reconnaissance de cette réalité ne nous apparaît pas pour autant comme une survalorisation ou une glorification de leurs capacités (comme certains, à l’instar de Gill, le craignent [2007, 2008b, 2012], voir aussi Corsianos : 2007)[1].
L’agentivité sexuelle des jeunes femmes : quelques éléments de définition
On définit généralement l’agentivité comme la capacité d’agir de façon compétente, raisonnée, consciencieuse et réfléchie (Smette et al.: 2009 : 370). Lorsqu’on applique le concept au domaine de la sexualité, on parle d’agentivité sexuelle. Ce dernier concept – de plus en plus utilisé dans les études sur le genre et les jeunes – peut être défini par la capacité des hommes et des femmes de prendre en charge leur propre sexualité et de l’exprimer de façon positive. Il fait référence au respect de soi-même, de ses valeurs et de son intégrité. Est ainsi « agent sexuel » celui qui est capable d’exprimer librement ses désirs dans ses relations et qui se sent en confiance dans l’expression de sa sexualité (Averett et al. : 2008 :. 332; Hammers, 2009 : 781). L’agentivité s’exprime aussi par le sentiment d’avoir « droit » (« to feel entitled ») au désir et au plaisir (Hammers : 2009), tout autant que par le fait de connaître ses propres limites (Averett et al. 2008, Hammers : 2009 : 782). La notion de « contrôle » est y donc centrale, tout comme l’idée d’action : Albanesi (2009 et 2010), définit d’ailleurs l’agentivité sexuelle comme « la volonté d’exercer du pouvoir dans le cadre d’une relation sexuelle » (2010 : 10) et distingue très clairement le fait d’exercer réellement du pouvoir de la capacité seule d’exercer du pouvoir dans ses relations. Selon l’auteure : While all individuals have the capacity to exert power – if an individual desires a specific outcome but she or he makes no attempt to affect that outcome – I do not define the capacity alone, as agentic. (idem, ibid.) De plus, l’agentivité sexuelle ne se limite pas à l’agir, mais renvoie également à l’idée de se sentir et se savoir auteur de ses actes : ainsi, le fait d’adopter une attitude passive ou soumise ou encore de rejeter le blâme et la responsabilité de sa participation sexuelle sur son partenaire seraient tous deux signes de comportements non agentiques (Albanesi , 2009)[2]. Ainsi, l’attitude observée par Tolman (1999) et par Gilmartin (2006) chez de jeunes femmes qui haussaient les épaules pour justifier leurs actes sexuels, se disant « C’est juste arrivé » (It just happened), ne serait pas synonyme d’un comportement « agentique ». Gilmartin et Tolman ont en effet observé que certaines jeunes femmes avaient tendance à attribuer leurs activités sexuelles hors couple à des coïncidences et à s’en détacher pour éviter de devoir porter le stigmate social relié à la promiscuité. La dissociation qu’elles adoptent alors – ce haussement d’épaules du « It just happenned », ce détachement pour éviter la frustration de ne pas avoir fait ce qu’elles « auraient dû faire » – leur permet de garder intacte la partie non sexuelle de leur vie, car elles placent la sexualité « de côté », la rendent secondaire, « comme le feraient de bonnes petites filles » (idem: 445). Cette stratégie, qui constitue une conséquence pernicieuse du double standard, punit doublement les filles, car le recours à cette dissociation ne les rend pas plus libres – au contraire :"These young women were having sex, but this was not the same as making confident sexual choices or being sexual agents." (Gilmartin :p. 445-446) Ainsi, pour être agent sexuel, il ne suffirait pas de dire « oui » au désir et à la sexualité, mais de le faire sur des bases qui nous conviennent, sur des bases de liberté. De la même façon, lorsqu’une personne refuse certains actes parce qu’elle sent une pression sociale de dire « non », le refus est loin d’être agentique. Averett et al. (2008), a déjà montré que courant américain qui incite les jeunes filles à « simplement dire non » (« Just Say No ») n’encourage pas les adolescentes à baser leur décision sur leur désir ou leur volonté, mais tente d’induire chez elles le réflexe d’une réponse qui serait toujours négative, que ce soit pour les protéger ou parce qu’il est mal vu qu’une fille de leur âge soit active sexuellement (odem : 332). Mais même le fait de dire « non » dans un contexte social qui nous pousse à le faire ou de hausser les épaules peuvent être des comportements agentiques, puisque comme il s’agit de stratégies, il se peut qu’une jeune femme désire en effet contrôler certaines facettes de sa sexualité. Il y a donc une distinction à faire entre les comportements en tant que tels et les motifs qui justifient et guident la décision d’adopter ces comportements (idem : 332; voir aussi Albanesi : 2009). Cette distinction est très importante pour régler plusieurs des querelles sur la question de l’agentivité sexuelle, notamment en ce qui concerne son opérationnalisation dans la recherche. Agentivité, perception du pouvoir sexuel et normativité : comprendre le débat
Comme nous venons de le voir, il existe une certaine limite à déterminer à l’avance ce qui constitue un comportement agentique et ce qui constitue, à l’inverse, un comportement non agentique. Cette limite est bien apparente lorsqu’il est question de comportements que l’on serait tentés de juger comme « malsains » (participer à de la pornographie, par exemple). En classant automatiquement comme « non agentiques » de tels comportements sans interroger les motivations des filles qui les adoptent, on discrédite le pouvoir décisionnel des femmes, d’une part, et on émet un jugement sur les comportements sexuels que les jeunes femmes « sensées » ou « informées » voudraient ou ne voudraient pas adopter, d’autre part. Ce faisant, on cesse de reconnaître leur agentivité sexuelle et on juge leurs activités sexuelles en les opposant à une certaine « norme » (celle de la morale, celle du féminisme traditionnel, celle que l’on attend des filles, etc.). En opposant l’agentivité des filles aux standards et aux attentes des autres, on réactualise les jugements moraux sur la sexualité des filles « under the pretext that girls with sexual agency make "good" sexual choices » (Hasinoff : 2010 : 78). Ce qui, en bout de piste, « merely reinscribe gendered sexual normativity as the only choice mentally healthy girls can legitimately make » (idem: 264). En gardant en tête une image de la sexualité qui soit souhaitable et qui corresponde à la « véritable » agentivité des filles, on crée un « idéal » de la sexualité qui, en plus d’être normatif, serait, selon Lamb (2010a) difficile à atteindre : "When we feminist theorists are done saying what good sex should not be, we can only create an unachievable ideal of what it should be, offering up fantasies of what we hope girls can achieve without regard to whether adult women have achieved such ideals in any uncomplicated and longlasting way." (idem : 302) Mais pa crainte d’instaurer une nouvelle norme basée sur une vision particulière de ce que devrait être la sexualité des filles, doit-on pour autant considérer que toutes les pratiques sexuelles s’équivalent? Gayle Rubin, anthropologue et théoricienne de la sexualité ayant été l’une des premières, avec Foucault, à avoir apporté l’idée que la sexualité n’existe pas en dehors des discours et de la culture, estime que cette tendance à vouloir catégoriser les comportements sexuels en comportements « souhaitables » ou « non souhaitables » serait une erreur : « Une des idées les plus tenaces en matière de sexe, c’est qu’il y a une et une seule bonne façon de faire l’amour, et que tous devraient le faire de la même manière. », écrit-elle en 1984 dans son article « Penser le sexe », qui est désormais devenu un classique (Rubin : 2010 [article de 1984] :163). Selon cette auteure, les positions qui tendent à stigmatiser certaines pratiques, comme le fétichisme ou la pornographie, seraient « régressi[ve]s » (idem :133) et donc tout autant infécondes, si nous continuons la réflexion, que celles qui visent à faire du désir et de la sexualité active une « norme » pour les femmes. Elle-même a d’ailleurs ardemment défendu les pratiques sadomasochistes (S&M), et a trouvé plus difficile d’avouer qu’elle pratiquait le sadomasochisme que de se déclarer lesbienne (2010 [1981] :128). Mais malgré l’apport de Rubin dans le débat, cette distinction entre pratiques « souhaitables » et « non souhaitables » semble toujours bien présente aujourd’hui. Par exemple, Amy Hasinoff (2010) a observé que les médias et même certaines lois et dispositions légales aux États-Unis ont tendance à « démoniser » certains actes sexuels pratiqués par les filles, sans égard à l’absence ou la présence de leur consentement, et encore moins à leurs propres perceptions de l’acte. Son étude, qui porte sur les liens entre l’agentivité sexuelle et les pratiques du sexting[3] par les adolescentes, montre que les dispositions légales, les commentaires populaires et même les interventions de certaines chercheuses féministes dans les médias sur ces pratiques considèrent « invariablement » les pratiques du sexting par les adolescentes comme le résultat d’un acte impulsif, non réfléchi, accompli par des adolescentes que l’on considère « victimes » parce qu’elles ne sont pas majeures, et parce que selon les perceptions dominantes, les jeunes filles devraient être innocentes et asexuelles. Or, paradoxalement, écrit-elle, les discours médiatiques blâment ces mêmes adolescentes pour leur propre victimisation (. 3, 12, 21, 59, 62, 241, 268 et plus) et en font ainsi des « victimes responsables ». Les filles qui envoient une photo osée d’elles-mêmes à leur copain seraient ainsi d’une part victimes des messages sexualisés des médias, de la pression des garçons, de leurs hormones ou encore de leur manque de confiance en elles-mêmes et de leur besoin d’attention déplacé (p. 17) et, d’autre part, responsables parce qu’en mettant l’accent sur un discours « d’autocontrôle » comme stratégie de prévention, l’on tient injustement les filles en quelque sorte « responsables » de prévenir la violence sexuelle et le harcèlement des garçons (et ce, même quand les échanges sont consensuels) ( : 47 et 12). Cette « panique morale » concernant le sexting proviendrait, selon Hasinoff, à la fois d’une préoccupation exagérée des effets des médias sur les adolescents et d’une crainte non fondée de la sexualité adolescente et de l’agentivité sexuelle des jeunes filles (p. 13 et 18), mais aussi d’une conception problématique de l’agentivité sexuelle issue des discours postféministes et libéraux, puisque, selon Hasinoff, « …this early 21st century post-feminist girl-power moment not only demands that girls live up to gendered sexual ideals but also insists that actively choosing to follow these norms is the only way to exercice sexual agency » . iii-iv). Une telle conception étroite (car basée sur des normes) de l’agentivité constitue sans aucun doute une fausse route. Mais comment concevoir l’agentivité sexuelle de façon à permettre son opérationnalisation dans les études tout en évitant de tomber dans le piège de la normativité? Certains auteurs ont suggéré de concevoir l’agentivité « réelle » comme une agentivité vécue de façon « authentique », c’est-à-dire qui a lieu lorsque la jeune femme se « sent bien » dans sa sexualité et dans son corps – un concept auquel on réfère lorsqu’on parle d’« embodied sexuality » (sexualité incarnée). Cette sexualité « incarnée » s’opposerait en principe à la « performance », où la jeune fille agirait en quelque sorte pour se « donner en spectacle », ou en se soumettant au regard des autres (Lamb : 2010a :301). Mais une telle conception, basée sur des critères d’authenticité, prête aussi flanc aux critiques : “Even if she [une fille qui agirait sexuellement à la façon des stéréotypes marchands] were to be feeling sexual feelings in her body (…), these theorists would most likely argue that it is still not embodied for to perform "sexy" means to take the perspective of the male looking on.” (Lamb : 2010a : 301) Il serait alors trop facile de considérer qu’elle adopte des comportements jugés non agentiques en argumentant qu’elle a appris à agir dans un système patriarcal qui récompense (en attention, par exemple) ces comportements, ou encore qu’elle aurait développé une « fausse subjectivité » (idem, ibid.). À l’inverse, même si une femme adoptait des comportements en accord avec les valeurs féministes libérales, et même si elle adoptait un discours basé sur le choix et l’authenticité, Lamb croit que l’on pourrait toujours douter de l’authenticité de sa parole : «[ …]who’s to say that when a girls does look within, whe won’t find another packaged version of teen sexuality [soit celle de la "good girl" cherchant à être aimée]? » idem: 302) Ainsi, même si le critère d’authenticité, en soi, puisse sembler faire partie intégrante de la définition d’agentivité, plusieurs théoriciennes doutent justement de l’authenticité de la perception d’authenticité des jeunes filles que l’on interrogerait. Ce qui amène Lamb à trancher : « Authentic sexuality is hard to find and feminist theorists may do best to leave that quality out of the mix. » (idem, ibid.) Même s’il nous semble bon d’abandonner ce critère, il nous semble important de ne pas pour autant mettre en doute la parole des filles et des jeunes femmes, sans quoi nous trahissons directement l’une des raisons premières pour lesquelles on cherche à utiliser le concept d’agentivité, soit de donner une légitimité de parole aux filles. Et si, plus encore, on raconte aux femmes et aux filles qu’elles ne peuvent croire à leurs propres perceptions de ce qui constitue une sexualité plaisante et « empowered », elles seraient alors, estime Peterson (2010), laissées sans orientation, sans indices de qui pourrait constituer une sexualité saine idem : 308-309). C’est pourquoi, dans notre étude, nous avons priviliégié une approche où nous avons mis l’accent sur le fait de se sentir « bien » dans sa sexualité. Ainsi, pour être considéré agentique, un comportement devait être effectué en accord avec la volonté des participantes de l’adopter, ce qui nous évitait de devoir porter un jugement sur les comportements qu’elles avaient voulu ou non adopter. Leurs sentiments et leurs motivations nous importaient davantage que la valeur de leurs comportements, et leur explication du contexte suffisait pour comprendre les rapports de forces qu’elles ont rencontré et qui minaient – ou rendaient plus aisé – l’exercice de leur agentivité. S’il semble si difficile d’admettre que des femmes puissent être « empowered » dans des situations où s’exercent – forcément – des forces sociales contre elles, c’est peut-être, selon Peterson (2010), parce qu’on considère simultanément l’empowerment et l’agentivité à deux niveaux : soit on conçoit l’empowerment et l’agentivité comme des éléments nous permettant d’exercer le pouvoir de faire quelque chose (power to), soit on les définit comme le sentiment d’exercer du pouvoir sur quelque chose (power over); sur des structures sociales, par exemple. Car une jeune femme peut être simultanément « empowered » à certains niveaux, et « disempowered » à d’autres (ibid.). C’est peut-être en confondant les deux niveaux que le débat devient si binaire et polarisé : soit on insiste sur la capacité d’action des individus, soit on accentue l’effet contraignant des structures (voir à nouveau Fraser et Bartky : 1992 : 17). Mais le débat n’a pas à être si polarisé; il peut au contraire être nuancé. Comme on l’a vu, le terme « agency » implique nécessairement la notion de contrainte, et c’est cette notion de contrainte qui, paradoxalement, permet la possibilité d’une puissance d’agir (voir à ce sujet Butler : 2004 [1997], p. 15; note des traducteurs). En ce sens, notre conception de l’agentivité s’apparente donc à celle décrite par Hasinoff dans son étude sur le sexting par les jeunes filles, c’est-à-dire qu’elle désigne un pouvoir d’agir malgré les contraintes et qui s’exerce au cœur même de celles-ci : "Even as I subscribe to the Foucaultian model of the subject whose desires and comprehension of herself as a subject are created within discourse, I simultaneously argue that subjects can still be said to act as agents within these parameters. […] In this project I rely on a postcolonial feminist conjecture that agency is always constrained, contextual, and relational." (Hasinoff : 2010 : 20) Une telle définition du concept permet de concevoir que l’on puisse faire des choix même dans une société marquée par l’exploitation du corps des femmes. Mais le problème est aussi dû au fait que la compréhension du concept est éclairée d’un côté par la théorie féministe seule (dans le cas notamment de Gill), et de l’autre par la théorie doublée d’études empiriques (dans le cas par exemple de Duits et van Zoonen). Rosalind Gill, par exemple, conçoit exclusivement l’agentivité dans un cadre d’analyse consumériste (2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2010, 2011, etc.). Elle-même précise dans son article de 2008b : « I start not from research with young women but from constructions of female agency in the media, specifically advertising. » (idem : 38). Même si elle se dit bien consciente que les médias n’offrent pas qu’un seul modèle de féminité ou de sexualité aux filles et que les recherches sur les médias ont depuis longtemps dépassé les notions de seringue épidermique ou d’imitation directe (idem :739), son analyse reste fortement teintée par les modèles d’agentivité « détournée » que l’on retrouve dans la pornographie, dans les publicités et à la télévision, comme si le pouvoir de séduction n’était véritablement que la seule modalité de pouvoir réellement exercée par les filles. Mais comme nous l’avons mentionné en introduction, cette représentation de l’agentivité est justement mise en scène, factice, et n’implique pas nécessairement que l’exercice de l’agentivité dans « la vraie vie » soit impossible. D’ailleurs, de nombreuses études empiriques souscrivant à une telle conception de l’agentivité ont démontré qu’il était effectivement possible de faire preuve d’agentivité dans sa vie sexuelle, dont la nôtre (Lang,: 2013). L’agentivité sexuelle dans les études empiriques
S’il est difficile de définir l’agentivité sexuelle, il l’est encore plus de rendre le concept opérationnel. Comment utiliser le concept de façon concrète dans la recherche? La démonstration de l’agentivité ne se situant pas dans le comportement en soi, mais dans la volonté d’adopter ce comportement et de l’exercer, il est inutile de dresser une liste a priori de comportements jugés « agentiques » ou « non agentiques ». Pour déterminer si les participants et les participantes de diverses études exerçaient de l’agentivité sexuelle, certains auteurs ont eu recours à des questionnaires, des entrevues ou des écrits narratifs effectués par les participants. On leur pose généralement des questions sur leurs attitudes envers la sexualité, sur leur capacité à communiquer leurs désirs, et sur la perception de leur niveau de contrôle dans leurs relations, le tout selon un devis de recherche encourageant la réflexion et la réflexivité des participants (voir par exemple Averett et al. : 2008 et Allen et al. : 2008). Comme nous l’avons mentionné, il est important de s’informer des motivations qui mènent aux actes, plutôt que de simplement considérer un acte en lui-même, car un même comportement effectué dans des conditions identiques pourrait très bien se révéler « agentique » pour une fille et « non agentique » pour une autre. Pour notre part, nous avons demandé à des jeunes femmes franco-canadiennes âgées de 17 à 21 ans de décrire leurs expériences de la sexualité (présentes et passées) dans un blogue, puis nous les avons rencontrées pour un entretien individuel semi-dirigé[4]. Nous leur avons posé des questions sur la qualité de leurs relations avec leurs partenaire3s sexuels, ainsi que sur le contrôle qu’elles estimaient avoir exercé en diverses situations. Surtout, nous leur avons posé des questions sur le contrôle qu’elles auraient alors souhaité exercer en ces mêmes situations. Pour communiquer la distribution du pouvoir dans leurs couples ou avec leur(s) partenaire(s), nous avons parfois utilisé l’image de la balance : en effectuant des mains le geste de la balance (une main représentant la participante interviewée et l’autre, ses partenaires sexuels), nous avons demandé aux participantes de notre recherche de nous dire si elles estimaient qu’elles avaient eu plus, moins ou autant de pouvoir que leur partenaire sexuel dans une situation précise. L’exercice était répété pour comparer diverses situations ou diverses relations amoureuses entre elles (ou encore différentes périodes d’une même relation) afin de déterminer l’évolution de leur agentivité et les circonstances permettant plus facilement l’expression de cette agentivité. En observant les justifications mises de l’avant pour expliquer un comportement, la description des participantes de leur propre pouvoir et l’exposé de leurs expériences, il est possible de décrire qualitativement les démonstrations de leur agentivité en diverses situations, de voir les obstacles à son expression, de leurs expériences à celles des autres participantes, et ainsi d’obtenir un portrait riche et nuancé de la démonstration de l’agentivité par les participantes. Il est bon de rappeler, toutefois, qu’une conception binaire de l’agentivité (agentique/non agentique) est souvent insuffisante pour qualifier les comportements. Car tout n’est pas blanc ou noir dans l’expression de l’agentivité, qu’elle soit sexuelle ou autre, et l’acquisition de l’agentivité sexuelle, tout comme l’acquisition de l’autonomie et du sens des responsabilités (Smette et al. :. 355), se fait souvent de façon fragmentée et non linéaire. Plus encore, la capacité d’une personne à démontrer de l’agentivité peut être situationnelle et contingente à certains éléments. Par exemple, une jeune femme qui, en toutes autres situations, démontre facilement de l’agentivité, peut perdre tous ses moyens devant un garçon (ou une fille) pour qui elle a le béguin, ou qui se montre particulièrement manipulateur ou manipulatrice ou insistant(e) (voir Lang : 2013). En général, toutefois, les participantes estiment que l’amélioration de l’exercice de leur agentivité dépend de deux choses : de leur niveau d’expérience et du choix de leur partenaire. Lorsque celui-ci les écoute et les respecte, et lorsque les participantes ont suffisamment confiance en leurs capacités pour s’exprimer, les conditions idéales sont en place pour qu’elles puissent agir véritablement selon leurs désirs et leurs besoins et ainsi qu’elles puissent exercer plus facilement de l’agentivité sexuelle. Lamb (2010a) avait déjà avancé qu’il faudrait prendre en compte « l’autre » et les sentiments amoureux dans la définition de l’agentivité sexuelle, car même si celle-ci peut s’exprimer « en soi », dans le rapport à son corps ou dans la façon de percevoir ou de s’autoriser la sexualité, par exemple, le ou la partenaire aimant(e), attentif(ve) ou respectueux(se) semble être conditionnel à l’expression de l’agentivité sexuelle des filles. Nos résultats corroborent cette observation, ce qui nous pousse à souligner l’importance d’intégrer la dimension relationnelle au concept d’agentivité sexuelle, chaque action étant située microsocialement tout autant que macrosocialement. À titre d’exemple, trois participantes de notre étude – qui ont toutes vu leur capacité d’agentivité augmenter au fil du temps – expliquent ici ce qui a pu, selon elles, permettre cette évolution; leurs citations illustrent les deux dimensions qui leur semblent permettre cette amélioration : « Je te dirais que ma sexualité s'est très très grandement améliorée avec mon chum de présentement, qui est l’homme de ma vie, d’ailleurs, […] à cause du respect mutuel et de la communication. […] On est comme dans un état fusionnel. Il dit quelque chose et je le comprends tout de suite. Ça améliore grandement toutes les relations, ainsi que les relations sexuelles. (Gabrielle, 19 ans) Je pense que le choix des gars va avec mon évolution. Les expériences de vie, et tout, ça a fait que j'étais plus mature, et que j'ai pu choisir quelqu'un qui m'aimait vraiment et qui me respectait. (Laurence, 19 ans) Je dirais que la plus grande évolution, c’est de mon côté, de comment je me sens à l'aise. Plus ça avance, mieux je me sens, et ça se fait ressentir même dans la vie de tous les jours, pas nécessairement juste dans [la sexualité]. Ça fait [aussi] que, côté sexualité, je me sens plus une femme. Mentalement, tu réalises des choses, tu réalises que dans la vie, c'est important de s'aimer, plein de choses quand même assez grandes. (Juliette, 20 ans) Surtout, nous avons pu constater, par notre étude, que la manifestation de l’agentivité sexuelle n’est ni une illusion, ni un leurre, mais une condition sine qua non à leur épanouissement. Nous avons par ailleurs pu observer, à l’instar de Duits et van Zoonen (2007), que les jeunes femmes et les adolescentes sont capables de parler par et pour elles-mêmes des situations où elles font preuve d’agentivité, et des cas où, au contraire, elles peinent à en exercer. À titre d’exemple, Amélie, 20 ans, décrit ici de façon détaillée à quel point il lui semble difficile d’exercer de l’agentivité sexuelle avec son partenaire actuel, alors qu’avec son partenaire antérieur, elle arrivait à exercer plus de contrôle : Amélie : Lui, on dirait que je le laisse contrôler tout. On dirait qu'avant, avec mon ex, souvent, je faisais les avances, tandis que là, je n'ose pas les faire. C'est bizarre un peu; souvent j'ai vraiment envie [de faire l’amour], mais je ne fais rien, parce que je me dis, s'il en avait envie, il me ferait des avances. On dirait que j'attends tout le temps que ce soit lui, et quand on le fait aussi, c'est tout le temps lui qui décide comment on se place. Je ne prends aucun pouvoir on dirait. Intervieweuse : Aimerais-tu ça en avoir plus? Amélie : Oh oui. Souvent, on dirait que j'ai des envies, et que je ne fais rien. Tandis que si je faisais des avances, j'aurais ce que [je veux]. Intervieweuse : Tu dis que tu n'as aucun pouvoir. Est-ce que c'est vraiment 0 % du pouvoir pour toi, et lui 100 %? Amélie : Il me laisserait en avoir, c'est sûr. Ça ne le dérangerait vraiment pas, et peut-être même qu'il aimerait mieux ça, mais là tout de suite on dirait que je ne m'en donne vraiment pas. Je pense que j'en ai zéro. Intervieweuse : Comment penses-tu pouvoir te rendre à un meilleur partage du contrôle? T’en sens-tu capable? Amélie : J’en serais capable certain. C'est dans ma personnalité; avant, avec mon ex, [j’en étais capable.] […] Je me dis que ce serait facile de juste reprendre ce contrôle-là, j'ai ça en moi, mais c'est juste que tout de suite, je ne le fais pas. Intervieweuse : Pourquoi? Amélie : Je ne veux pas me refaire laisser. Amélie est ici clairement consciente de la variation de sa capacité à exercer de l’agentivité dans ses relations, qu’elle sait en grande partie dépendante de la confiance qu’elle s’accorde. Cette citation issue de notre thèse[5] nous semble montrer qu’il est possible – et souhaitable – de faire confiance à la parole des filles, puisqu’elles sont souvent les mieux placées pour parler des situations qui les concernent au premier chef. Cette confiance, ce crédit qu’on leur accorde, n’évacue en aucun cas la possibilité de discuter des structures sociales dans lesquelles leurs expériences sont nécessairement situées. Le fait de se positionner contre l’utilisation du concept d’agentivité (par exemple en raison du souci d’une « deuxième » normativité qu’il pourrait induire) ne nous semble donc pas rendre justice à la réflexivité des femmes, à leur voix et à leurs expériences, puisque, comme notre étude le montre clairement (et comme d’autres chercheurs l’ont montré avant nous), l’intégration du concept dans une grille d’analyse se révèle au contraire pertinente et utile pour rendre compte adéquatement du discours des participantes, des rapports de force qu’elles rencontrent, des façons dont elles négocient la sexualité avec leur(s) partenaire(s) ainsi que des rapports qu’elles entretiennent avec les normes sociales. Biographie:
BibliographieAlbanesi, Heather Powers. 2010. Gender and Sexual Agency: How Young People Make Choices about Sex. Lanham, Md, Lexington Books. Albanesi, Heather Powers. 2009. « Eschewing Sexual Agency: A Gender Subjectivity Approach », Race, Gender & Class, vol. 16, n° 1-2. Allen, Katherine R., Erica K. Husser, Dana J. Stone et Christian E. Jordal. 2008. « Agency and Error in Young Adults’ Stories of Sexual Decision Making », Family Relations, vol. 57. Averett, Paige, Mark Benson et Kourtney Vaillancourt. 2008. « Young Women’s Struggle for Sexual Agency: the Role of Parental Messages », Journal of Gender Studies, vol. 17, n° 4. Bereni, Laure, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard. 2008. Introduction aux Gender Studies : Manuel des études sur le genre. Bruxelles, de Boeck. Butler, Judith. 2004 [1997]. Le pouvoir des mots : discours de haine et pouvoir du performatif. Paris, Éditions Amsterdam. Corsianos, Marilyn. 2007. « Mainstream Pornography and "Women": Questioning Sexual Agency », Critical Sociology, vol. 33. Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2009. « Coming to terms with sexualization ». Conference of the International Communication Association, Session « Sex and Sexuality in Media Culture: Theory and Performance », Singapour, 20-25 mai. Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2007. « Who’s afraid of Female Agency?: A Rejoinder to Gill », European Journal of Women’s Studies, vol. 14, n° 2. Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2006. « Headscarves and Porno-Chic: Disciplining Girls’ Bodies in the European Multicultural Society », European Journal of Women’s Studies, vo. 13, n° 2. Emirbayer, Mustafa et Ann Mische. 1998. « What Is Agency? », American Journal of Sociology, vol. 103, n° 4. Foucault, Michel. 1994 [1976]. Histoire de la sexualité : La volonté de savoir. Paris, Éditions Gallimard. Fraser, Nancy et Sandra Lee Bartky (Éd.). 1992. Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture. Bloomington, Indiana University Press. Giddens, Anthony. 2005 [1984]. La constitution de la société. Paris, Presses universitaires de France. Gill, Rosalind. 2012. « Media, Empowerment and the "Sexualization" Debates », Sex Roles, vol. 66. Gill, Rosalind. 2011. « Sexism Reloaded, or, It’s Time to Get Angry Again », Feminist Media Studies, vol. 11, n° 1. Gill, Rosalind. 2010. « Mediated Intimacy and Postfeminism: A Discourse Analytic Examination of Sex and Relationships Advice in a Women’s Magazine », Discourse and Communication, vol. 3. Gill, Rosalind. 2009a. « Beyond the "Sexualization of Culture" Thesis: An Intersectional Analysis of "Sixpacks", "Midriffs" and "Hot Lesbians" in Advertising », Sexualities, vol. 12, n° 2. Gill, Rosalind. 2009b. « Supersexualize me! Advertising and the Midriffs », Feona Attwood (éd.), Mainstreaming Sex: The Sexualization of Culture, London et New York, I. B. Tauris. Gill, Rosalind. 2008a. « Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist Times », Subjectivity, vol. 25. Gill, Rosalind. 2008b. « Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency in Contemporary Advertising », Feminism & Psychology, vol. 18, n° 1. Gill, Rosalind. 2007. « Critical Respect: The Difficulties and Dilemmas of Agency and "Choice" for Feminism: A Reply to Duits and van Zoneen », European Journal of Women’s Studies, vol. 14, n° 1. Gill, Rosalind et Christina Scharff. 2011. « Introduction », dans Rosalind Gill et Christina Scharff (éd.), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Gilmartin, Shannon K. 2006. « Changes in College Women’s Attitudes Toward Sexual Intimacy », Journal of Research on Adolescence, vol. 16, n° 3. Hammers, Corie. 2009. « Space, Agency, and the Transfiguring of Lesbian/Queer Desire », Journal of Homosexuality, n° 56. Harvey, Laura et Rosalind Gill. 2011. « Spicing It Up: Sexual Entrepreneurs and The Sex Inspectors », Rosalind Gill et Christina Scharff (éd.), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Hasinoff, Amy Adele. 2010. No Right to Sext? A Critical Examination of Media and Legal Debates About Teenage Girls’ Sexual Agency in the Digital Age. Thèse de doctorat (Ph.D. Communication), University of Illinois at Urbana-Champaign. Lamb, Sharon. 2010a. « Feminist Ideals for a Healthy Female Adolescent Sexuality: A Critique », Sex Roles, n° 62. Lamb, Sharon. 2010b. « Porn as a Pathway to Empowerment? A Response to Peterson’s Commentary », Sex Roles, n° 62. Lang, Marie-Eve. 2013. La recherche d’informations sexuelles par de jeunes Franco-Canadiennes et ses liens avec l’expression de leur agentivité sexuelle. Thèse de doctorat (Ph.D. Communication), Université Laval. Lang, Marie-Eve. 2011. « L’agentivité sexuelle des adolescentes et des jeunes femmes : une définition », Recherches féministes, vol. 24, n° 2. Mahmood, Saba. 2005. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, NJ, Princeton University Press. [voir aussi version de 2012] Maxwell, Claire et Peter Aggleton. 2011. « Bodies and Agentic Practice in Young Women’s Sexual and Intimate Relationships », Sociology, vol. 46, n° 2. Maxwell, Claire et Peter Aggleton. 2010. « Agency in Action – Young Women and Their Sexual Relationships in a Private School », Gender and Education, vol. 22, n° 3. Peterson, Zoë D. 2010. « What is Sexual Empowerment? A Multidimensional and Process-Oriented Approach to Adolescent Girls’ Sexual Empowerment », Sex Roles, n° 62. Rubin, Gayle. 2010. Surveiller et jouir : Anthropologie politique du sexe. Paris, Epel. Smette, Ingrid, Kari Stefansen et Svein Mossige. 2009. « Responsible Victims? Young People’s Understandings of Agency and Responsability in Sexual Situations Involving Underage Girls », Young : Nordic Journal of Youth Research, vol. 17, n° 4. Tolman, Deborah L. 1999. « Asking some unasked questions ». En ligne [novembre 2012]. www.wcwonline.org. Références: [1] Maxwell et Aggleton (2011) ont justement déploré l’écart entre les écrits théoriques et les écrits empiriques portant sur l’agentivité (p. 306). [2] Dans le cadre, évidemment, d’une sexualité libre d’abus. [3] Le fait d’envoyer des messages ou des images à caractère sexuel à une connaissance par téléphone cellulaire ou par Internet. [4] Il faut noter que notre étude portait aussi sur leurs recherches d’information sur le Web en matière de sexualité. Le blogue a surtout servi à cette portion de notre recherche, mais servait aussi à « briser la glace » de façon à obtenir des discussions plus riches en entrevue. [5] Disponible en intégralité à l’adresse suivante : https://www.academia.edu/7585959/La_recherche_dinformations_sexuelles_sur_le_Web_par_de_jeunes_Franco-Canadiennes_et_ses_liens_avec_lexpression_de_leur_agentivite_sexuelle
labrys, études
féministes/ estudos feministas |